|
En 1890, taillandier à Albiez-Le-Vieux, petite commune près de Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie, Joseph Opinel fabrique les premiers modèles du couteau Opinel en douze tailles numérotées de 1 à 12. En 1890, c’est un jeune homme de dix-huit ans. Comme beaucoup en ce temps-là, il n’a pas fréquenté longtemps l’école et s’est retrouvé très tôt dans l’atelier de taillanderie paternel. Sa première tâche est d’achever la mise au point du modèle définitif de l’Opinel. Le bon sens, le confort de la prise en main, la commodité de la mise en poche avaient peu à peu déterminé la forme générale. La principale difficulté consistait à réaliser la fente où viendrait se loger la lame. Le plus facile était évidemment de donner un simple trait de scie, mais cette méthode, en fendant le manche dans toute sa longueur, avait le défaut d’en rendre l’extrémité opposée à la virole très fragile. Joseph conçut donc une machine peu compliquée mais ingénieuse : un simple bâti sur lequel coulissait une petite scie circulaire qui enlevait juste ce qu’il fallait de bois. C’est d’ailleurs une constante chez Opinel, un siècle après : on continue à concevoir les machines dont on a besoin, et tout, à Cognin comme à la Revériaz, est de conception Opinel. Du coup, la coutellerie se développa. Selon Placide Rambaud, en 1896 Joseph avait trois ouvriers qui fabriquaient journellement cinq douzaines de couteaux. C’était encore de l’artisanat, mais l’affaire devenait sérieuse. Cette même année, Joseph se mariait avec Marie-Henriette Sambuis, de la Maison Blanche (commune de Fontcouverte). En 1901, il s’installa dans un bâtiment moderne qu’il venait de construire un peu plus bas, vers le pont de Gevoudaz. Là, quinze ouvriers travaillaient, et il y avait même une dynamo qui fournissait l’électricité à tout le hameau. En 1909, Joseph Opinel déposa sa première marque de coutellerie. Jusque là, couteaux, serpes, outils divers étaient tout simplement marqués «Opinel» : ils sont aujourd’hui très recherchés des collectionneurs. Très vite, la réputation des couteaux Opinel dépassa les limites de la vallée. L’aïeul Victor-Amédée avait été colporteur : quoi de plus naturel que des colporteurs aient eu dans leur balle, parmi le fil et les aiguilles, quelques couteaux ? On a dit qu’Alexandre Balmain (le grand-père du célèbre couturier), qui réussit dans le colportage à la fin du XIXe siècle, emportait toujours quelques opinels dans ses tournées vers Düsseldorf ou Stuttgart.
En tout cas, le colportage ne pouvait être le seul moyen de diffusion, et Joseph Opinel passa très vite à une commercialisation qui, dès avant 1914, fit connaître ses couteaux en Suisse et en Italie. |
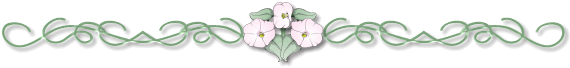
 Créé pour les montagnards de Savoie il y a plus de 100 ans, l'OPINEL est en parfaite harmonie avec la nature.
Sa robustesse, son manche en bois complice de la main, sa ligne indémodable en font un élément essentiel de notre patrimoine.
Créé pour les montagnards de Savoie il y a plus de 100 ans, l'OPINEL est en parfaite harmonie avec la nature.
Sa robustesse, son manche en bois complice de la main, sa ligne indémodable en font un élément essentiel de notre patrimoine.
 Mais ce nom, si prestigieux soit-il devenu, ne remplaçait pas une marque. Selon l’ouvrage de Jean-François Hirsch, «Le Coutelier» : «En 1565, dans les Statuts que les couteliers de Paris eurent par lettre patente du Roi Charles IX, il est stipulé que chaque Maître est obligé d’avoir un poinçon ou une marque, pour marquer son ouvrage, qui doit lui être donné par les quatre jurés, avec défense de prendre ou d’imiter le poinçon ou marque les uns les autres». «Afin d’éviter les contrefaçons, les marques devaient être déposées en «lieu sûr», au Greffe du Lieutenant de police pour Paris, au siège de la corporation ou chez le plus ancien Maître ou Juré pour les centres couteliers. Elles y devaient être poinçonnées sur une planche de cuivre, de plomb ou d’argent, afin d’en constater le dépôt et de pouvoir en conserver l’empreinte en cas de contestation».
Joseph Opinel déposa donc sa marque, en choisissant pour emblème la Main Couronnée. Pourquoi cette main aux trois doigts levés, annulaire et auriculaire repliés ? C’est que la capitale de la vallée, Saint-Jean-de-Maurienne, a adopté les armoiries du chapitre de sa cathédrale : «main bénissant d’argent, sur champ d’azur, vêtue de même». Alors, pourquoi ne pas choisir comme marque ces armoiries prestigieuses ? D’autant plus que cet emblème n’est pas le fait du hasard. Depuis le VIe siècle, la cathédrale de Saint-Jean-de-Maurienne abrite les reliques de saint Jean-Baptiste : trois doigts, de la main qui baptisa le Christ, rapportés d’Alexandrie d’Egypte par une jeune fille de la région, sainte Tygre ou Thêcle.
Quant à la couronne, elle serait là pour rappeler que la Savoie était un duché.
Mais ce nom, si prestigieux soit-il devenu, ne remplaçait pas une marque. Selon l’ouvrage de Jean-François Hirsch, «Le Coutelier» : «En 1565, dans les Statuts que les couteliers de Paris eurent par lettre patente du Roi Charles IX, il est stipulé que chaque Maître est obligé d’avoir un poinçon ou une marque, pour marquer son ouvrage, qui doit lui être donné par les quatre jurés, avec défense de prendre ou d’imiter le poinçon ou marque les uns les autres». «Afin d’éviter les contrefaçons, les marques devaient être déposées en «lieu sûr», au Greffe du Lieutenant de police pour Paris, au siège de la corporation ou chez le plus ancien Maître ou Juré pour les centres couteliers. Elles y devaient être poinçonnées sur une planche de cuivre, de plomb ou d’argent, afin d’en constater le dépôt et de pouvoir en conserver l’empreinte en cas de contestation».
Joseph Opinel déposa donc sa marque, en choisissant pour emblème la Main Couronnée. Pourquoi cette main aux trois doigts levés, annulaire et auriculaire repliés ? C’est que la capitale de la vallée, Saint-Jean-de-Maurienne, a adopté les armoiries du chapitre de sa cathédrale : «main bénissant d’argent, sur champ d’azur, vêtue de même». Alors, pourquoi ne pas choisir comme marque ces armoiries prestigieuses ? D’autant plus que cet emblème n’est pas le fait du hasard. Depuis le VIe siècle, la cathédrale de Saint-Jean-de-Maurienne abrite les reliques de saint Jean-Baptiste : trois doigts, de la main qui baptisa le Christ, rapportés d’Alexandrie d’Egypte par une jeune fille de la région, sainte Tygre ou Thêcle.
Quant à la couronne, elle serait là pour rappeler que la Savoie était un duché.