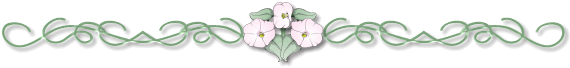| |
|
 Cinéma, Sculpture, Mode, Musique, Politique, Naturalisme, Etc... Cinéma, Sculpture, Mode, Musique, Politique, Naturalisme, Etc...

 LOUIS LUMIERE 1864 - 1948 LOUIS LUMIERE 1864 - 1948
Antoine Lumière exerce ses talents dans la photographie quand son second fils
naît à Besançon. Il s’appellera Louis, comme son grand-père maternel, imprimeur
parisien.
Donc, le petit Louis a 6 ans lorsque la famille part s’installer à Lyon. Le père
travaille chez Fatalité dans la « Peinture et Photographie ».
Quelques années plus tard, il ouvre son premier studio rue de la Barre.
Auguste et Louis se mettent déjà « dans le bain ».
L’aîné fait des études scientifiques et sera suivi par le cadet qui apprend également
le dessin et la sculpture.
PREMIER APPRENTISSAGE
Durant l’été, Louis tire le portrait des curistes d’Allevard et ramène la pellicule à
développer. Quant au studio paternel, il affiche « une bonne santé » et bénéficie de
quelques améliorations techniques.
A cette époque, la photographie était pratiquée avec des plaques émulsionnées en
chambre noire avant l’exposition et nécessitait une organisation et du matériel qui
assuraient le monopole des professionnels.
Fini les préparations et vive « les plaques sèches » qui révolutionnent le petit
monde de la photo, menacé d’ailleurs par l’appareil portatif.
Il faut donc trouver de nouveaux créneaux à ce marché.
Le père Lumière tente alors de se reconvertir dans la fameuse fabrication des
plaques sèches dont le « secret » sera trouvé par ses enfants après de considérables
recherches.
DE PROGRES EN PROGRES
L’affaire familiale devient une véritable industrie transférée à Monplaisir mais qui
connaîtra quelques difficultés économiques. Les plaques sèches sont enfin au point
et Louis baptise cette formule « Etiquette bleue » dont le succès va renflouer
l’entreprise familiale.
C’est alors qu’Antoine Lumière s’installe à La Ciotat et, déserte le labo pour la
viticulture tout en gardant un « oeil » sur l’objectif.
Le kinétoscope d’Edison sort en 1891 et monsieur Lumière Père encourage ses
fils à créer un procédé similaire. C’est Louis Lumière qui se charge d’améliorer le
kinétoscope et invente l’appareil cinématographe. Le mécanisme d’entraînement
immobilise l’image et permet sa projection agrandie.
La paternité de cette invention est largement revendiquée par d’autres concurrents,
qui mènent aussi les aventures de la recherche. Demeny, Marey et le grand Méliés
qui prend la voie du spectacle cinématographique, sont sur la liste.
1895, Léon Gaumont confirme les résultats de Louis Lumière et lui confie la
réalisation d’un appareil de prises de vues.
PHOTO DE FAMILLE... A LA CIOTAT...
Les fils Lumière mènent leurs affaires « bon train » !
Antoine jouit de l’aisance financière et ne manque pas de faire honneur à la fortune
familiale.
Il s’offre le domaine « Le Clos des Plages » à la Ciotat et reçoit de façon
grandiose famille, amis et relations d’affaires. Les Winkler (de Lyon) unis par
alliance aux Lumière puisque Louis épousa une des filles, composent le clan
illustre.
« SILENCE. ON TOURNE »
Le premier film qui fit le tour du monde, est à la fois familial et spectaculaire. Il
s’intitule « L’arrivée d’un train en gare de La Ciotat ». Il est présenté en
septembre 1895 dans la demeure du Clos. Cent cinquante invités assistent à cette
projection privée et découvrent les balbutiements du septième art...
La petite ville en garde encore un souvenir ému. Le Cinéma Eden où furent
projetés les premiers films Lumière continue de faire « tourner la bobine ».
Quant au Musée, il témoigne bien du séjour fructueux des Frères Lumières.
Mais la technologie cinématographique ne s’arrête pas là. Louis Lumière multiplie
les brevets qui assurent d’ailleurs la vie « dorée » à la famille.
Consécration honorifique : en 1935, il rentre à l’Académie des Sciences.
C’est à Bandol que Louis « s’éteint » à 74 ans.
« Pendant trente ans, ma famille s’est réunie à La Ciotat, où mon père possédait
une propriété. Nous étions parfois plus de trente à table, avec les neveux, les
cousins et les amis... Ma mère, une femme admirable, s’occupait de tout... »
L. Lumière
Retour
 GERMAINE RICHIER 1902 - 1959 GERMAINE RICHIER 1902 - 1959
A proximité de Salon, le petit village de Grans qui déploie ses belles façades
traditionnelles, est associé depuis 1902 au maître sculpteur le plus avant-gardiste :
Germaine Richier.
Elle grandit dans cette Provence retirée... A cette époque, l’avenir des femmes ne
s’inscrit pas dans un plan de carrière mais plutôt dans le dessein d’un horizon
limité.
Pour Germaine Richier, ce sera l’Ecole des Beaux-Arts de Montpellier.
Le futur rimera avec sculpture !
SCULPTEUR
C’est dans l’atelier de Gigue, ancien praticien de Rodin que Mademoiselle
« taille » son destin. En 1926, elle part à Paris, devient l’élève particulière de
Bourdelles et quatre ans plus tard, elle travaille en toute indépendance dans son
atelier avenue du Maine.
Sa première exposition est inaugurée à la galerie Max Kaganovitch à Paris en
1934. Le thème demeure encore classique : les galbes, les pleins et les déliés
respectent ses modèles mais annoncent déjà un style très personnel. Recherche de
l’aboutissement, de l’essentiel, de la fluidité composent le parcours de
l’artiste. La guerre est là et Germaine exprime la révolution qu’elle engendre sur
l’humanité. « Juin 40 » donne une interprétation de ces horreurs. Le monde animal
se substitue à la réalité, et devient son registre de prédilection. Ses oeuvres se
creusent, s’évident, se perforent. Sa violence effraie et sublime à la fois.
En 1948, elle expose à la fondation Maeght à Paris. Deux ans plus tard, l’artiste
déchaîne une controverse avec « le Christ » sculpté pour l’Eglise d’Assy.
Germaine Richier affirme sa démarche artistique qui est consacrée par le succès.
Parmi ses originalités créatrices, ses « plombs à fonds peints » qui contribuent à
réunir la sculpture et la peinture. « La ville », « La Toupie » se détachent des
toiles abstraites peintes par Hartung, Da Silva et Zao Wou-Ki.
D’autre part, le travail de la matière permet d’associer verre coloré et plomb fondu,
bronze peint et plâtres polychrome comme « Le cheval ». Les oeuvres de Richier
témoignent du potentiel de créativité de l’auteur.
« La Tauromachie » 1953, « La Sauterelle, grande » 1955, « La Fourmi » ,
« Le Sablier » sont quelques unes de ses interprétations mi-homme, mi-insecte
mais tellement précises dans la gestuelle des deux.
HONNEUR A LA GRANDE DAME
Premier Prix de Sculpture à la première Biennale de Sao Paulo, XXVIème
Biennale de Venise, exposition aux quatre coins du monde et bien sûr au Musée
d’Art Moderne de Paris, Germaine Richier est consacrée et son talent reconnu
par ses pairs.
Aujourd’hui, au détour des voyages, Germaine Richier est souvent présente dans
les Musées d’Art Contemporain. Le Musée Picasso d’Antibes a « Le Tombeau
de l’orage », la Fondation Guggheneim de Venise donne à Mademoiselle
Richier les honneurs de son jardin.
L'échiquier, grand bronze,(1959), 3,19 x 0,85 x 0,61 m, acquis par le fonds du patrimoine en 1998, 3,19 x 0,85 x 0,61 m, Mnam/Cci Centre Georges Pompidou, Paris.
Constituée de cinq figures autonomes, le Roi, la Reine, le Fou, la Tour, le Cavalier, cette œuvre majeure de Germaine Richier marque l'aboutissement de sa recherche et introduit dans sa démarche deux autres notions : le mouvement et la couleur. Initialement réalisées en plâtre peint, chacune des cinq sculptures qui forment un ensemble rythmé et ludique, peuvent être indifféremment disposés dans l'espace et invitent le spectateur à se déplacer à l'intérieur de ce dispositif. L'acquisition de l'Echiquier, grand, l'œuvre ultime de l'artiste, vient compléter le remarquable ensemble de sculptures de Germaine Richier conservées dans les collections publiques françaises : La Mante, 1944, La Chauve-Souris, 1946, L'Ouragan et l'Orage, 1947-1948, Le Griffu, 1952, La Fourmi, 1953, La Montagne, 1955-1956. L’Echiquier, grand n’a pu être acquis que grâce à l’aide de Madame Guitter.
Propos de l'artiste
"Mes sujets appartiennent au monde de la métamorphose (Orage, Homme dans la forêt) ; à cet animal qui est plus qu'un animal (la Mante) - ce sont les créatures fantastiques d'une époque que nous sommes incapables de reconnaître, mais qui est la nôtre, le monde des formes intervient sans cesse au moment de la recherche et de l'observation."
Le 31 juillet 1959 à Montpellier, Germaine Richier trouve le « repos du guerrier ». Le musée Picasso d'Antibes présente la même année la première rétrospective.
Retour
 César Baldaccini (CESAR) 1921 - 1998 César Baldaccini (CESAR) 1921 - 1998
« Je suis né à la Belle de Mai... »
C’est dans le quartier populaire de Marseille que le petit Baldaccini et sa soeur
jumelle font leurs premiers pas.
Le père est marchand de vin et l’adolescent rentre dans l’affaire familiale.
Il suffit des conseils d’un voyageur de commerce qui apprécie l’esquisse du petit,
pour que César se retrouve sur le banc des Beaux-Arts. Le premier professeur qui
le « forge » à la technique est Cornu, ancien praticien de Rodin.
Il part à Paris en 1942, après avoir obtenu une bourse, et réussit l’admission à
l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts .
Signe du hasard... Il habite la même maison qu’ Alberto Giacometti.
Stage dans un atelier d’ébénisterie dans le Var puis de céramiste à Montpellier où il
apprend à tourner...
CESAR, LE SCULPTEUR
C’est en 1947 que le jeune marseillais comprend son « affection » pour la matière.
Si certains artistes choisissent le fer pour exprimer leur langage, César l’utilise
d’abord par nécessité économique. Il débute avec le fil de fer et crée ses premières
sculptures en ferraille.
Dès 1954, il travaille dans une petite usine de la banlieue parisienne d’où sortiront
quelques pièces. Parmi elles, « Le Poisson », qui lui vaut le prix du « Collabo »,
sera acheté par le conservateur du Musée d’Art Moderne de Paris.
Il sculpte, utilise les déchets ferreux, soude, coupe et découvre le plaisir « charnel »
du matériau.
Picasso apprécie son travail et le lui fait savoir, les rencontres se multiplient et les
échanges sont fructueux.
1956... César signe ses deux premières oeuvres monumentales baptisées « La
Grande Duchesse » et « Le Diable » qui mesurent respectivement deux mètres et
trois mètres cinquante.
Quant au premier objet compressé, il apparaît en 1957... et bucolique, il se
nomme « Le déjeuner sur l’herbe » ! Deux boîtes de sardines écrasées donnent
naissance à un procédé nouveau qui deviendra célèbre... deviendra César... Les
expositions accueillent ces pièces de « l’autre monde » qui, critiquées ou
appréciées, ne laissent pas indifférent.
César observe la réaction de ses matériaux, compresse boîtes, pare-chocs,
voitures, fait feu de tout et mène un « train d’enfer » à la matière qu’elle soit métal,
polyuréthane ou cristal.
POUCE !
Son premier pouce en plâtre date de 1966, mesure 2 mètres de haut et s’expose au
milieu de Calder et Giacometti.
C’est le résultat d’une recherche sur le modèle de la main commandé par Claude
Bernard.
Marseille a aussi son pouce La sculpture monumentale jalonne le carrefour du
Boulevard d’Hambourg comme pour dire « Stop » aux automobilistes.
BIJOUX...JOUJOUX...CAILLOUX...
L’or et l’argent se tordent à plaisir dans les mains de César et deviennent
véritablement des pièces d’art.
« Ce qui compte, c’est la beauté de la matière, et toutes les matières sont
précieuses quand je leur parle : le pneu, l’or, le papier, la tôle ».
RECONNAISSANCE UNANIME...
Biennale de Sao Paulo... de Carrare... de Venise... Prise du Carnegie Institute
de Pittsburgh... aux côtés de ses compagnons les plus éminents.
Marianne et Pierre Nahon, porte-drapeau de l’Art Contemporain, soutiennent le
travail de César l’artiste et lui ouvrent les portes de leur célèbre galerie
Beaubourg.
1980... Exposition en duo avec Arman. Séries de bronzes soudés...
L’artiste crée aussi une plaque surdimensionnée pour la fondation Cartier à Jouyen-
Josas qui est l’Hommage à Eiffel.
César travaille et vit à Paris mais demeure l’enfant de Marseille.
Portrait d'un CESAR
C’est en 1975 qu’est créée l’Académie des Arts et Techniques du Cinéma. L’année suivante a lieu, le 3 avril 1976, la première nuit des César sous la Présidence de Jean Gabin. Il a ainsi fallu près d’un demi siècle avant que la France suive l’exemple américain de la remise des Oscars.
A l’origine de cette idée, Georges Cravenne qui adolescent dans les années 20, est fasciné par la petite statuette de l’homme à l’épée curieusement baptisé Oscar. Bien des années plus tard, la rencontre avec une autre petit homme à l’accent prononcé et à la faconde provençale, César, allait concrétiser le vieux rêve. La France, berceau du 7ème Art, pourrait enfin récompenser son cinéma et démentir Louis Lumière dont l’invention, prétendait-il, n’avait aucun avenir.
Le César : © Académie des César
30cm de haut, 3 kg 200 de bronze poli.
Hauteur : 30 cm sur une base de 8 sur 8 cm.
Poids : 3 kilos 200. Comme toutes les récompenses, un César est lourd à porter.
Composition : bronze naturel et non doré à l’or fin. En fait, c’est un polissage très minutieux qui lui donne son aspect brillant. L’objet est creux. Le procédé de fonderie est celui dit à cire perdue. Il faut de 12 à 15 heures de travail pour fabriquer un César. Si habituellement, dix-neuf César sont attribués, on en fabrique vingt-cinq chaque année.
Coût : élevé bien sûr, chaque pièce étant une œuvre d’art, mais tenu strictement confidentiel par l’Académie des Arts et Techniques du Cinéma. Seuls les gens de la profession peuvent éventuellement acquérir le César sous réserve d’en acquitter le coût. Le cas peut se produire, par exemple, si l’œuvre primée possède plusieurs producteurs, réalisateurs, etc. Aucun César à ce jour n’a été ni refusé, ni perdu. Par contre, le domicile d’Ariane Ascaride ayant été cambriolé, on lui a volé son César pour Marius et Jeannette.
Fabrication et Fonderie : Atelier Régis Bocquel en Seine Maritime.
Anecdote : A l’origine, un seul projet fut présenté par César à Georges Cravenne. Le modèle n’a subi aucune modification depuis.
« ... J’ai découvert que j’avais l’accent du Midi. J’ai dit « Tiens c’est fou ce que
tu as l’accent du Midi ». Je vis ici, à Paris, depuis si longtemps et je suis encore
un provençal. C’est curieux ! Ce sont mes racines ».
César
Retour
 CHRISTIAN LACROIX 1951 CHRISTIAN LACROIX 1951
Christian Lacroix est né à Arles le 16 mai 1951 sous le signe très symbolique du Taureau.
Arles... « J’y suis né mais de l’autre coté du Rhône dans un bourg appelé
Trinquetaille ».
Son enfance est baignée de ce quotidien provincial qu’il évoquera à chaque
collection et fera connaître au monde entier.
Les devoirs, la maison au carrefour de Nîmes, des Cévennes, de la Camargue,
des Saintes Maries de la Mer... tel est le tableau dans lequel évolue aisément le
jeune arlésien.
Sa famille paternelle a une entreprise de mécanique agricole à Trinquetaille.
Les hommes travaillent, les femmes sont élégantes, habillées de tailleurs foncés
avec le petit collier de perles grises comme accessoire et les ongles manucurés.
Sa mère affiche des tenues sport raffinées.
Ses grands parents maternels habitaient au-dessus de l’atelier et de la boutique
d’un bourrelier.
Des odeurs de cuir, de graisse et de cire s’épanouissent comme un parfum de
Provence.
Là, Madame Lacroix commandait des ceintures pour ses enfants, l’Empereur
Bao-Daï faisait réparer ses étuis à revolver et Cocteau passait des heures à
évoquer l’artisanat.
Quant à l’adolescent, il va au collège, fréquente le café Malarte, se rend au musée
Réattu. Il accompagne son père aux corridas et fréquente les cocktails où il
aperçoit Picasso et Cocteau.
L’été est rythmé par les airs de Verdi, Bizet, Gounod qu’il va écouter au théâtre
Antique.
Il y a aussi la fête des costumes d’Arles qu’il ne rate sous aucun prétexte.
DEPART
Son adolescence voit naître une passion pour l’Angleterre d’Oscar Wilde et des Beatles, Barcelone et Venise . Il étudie alors l’histoire de l’Art à la faculté des Lettres de Montpellier puis à Paris en 1973 à la Sorbonne et à l’Ecole du Louvre, se destinant alors à être conservateur de Musée.
Et puis les voyages... Naples, Gênes, le Pirée, Le Péloponnèse ouvrent le regard
sur d’autres horizons.
Quant à Marseille, Lisbonne et Venise, Lacroix les considère un brin orientalistes.
1973 PARIS... LE DESSEIN DE LACROIX.
Il fait une maîtrise sur « le costume à travers la peinture du XVIIème siècle ». Il
suit parallèlement les cours de l’école du Louvre destinés au concours de
conservateur qu’il échoue d’ailleurs.
Mais Lacroix a le trait stylisé, le crayon alerte et l’oeil sensibilisé aux nuances
colorées. Il dessine et croque les élégantes.
Quelques rencontres déterminantes lui font prendre un autre chemin : Françoise, qui va devenir sa femme, lui fait découvrir Paris et l’encourage à dessiner ; Jean-Jacques Picart, attaché de presse et conseiller pour divers Créateurs et Maisons de luxes, le fait entrer chez Hermès en 1978, puis chez Guy Paulin en 1980.
En 1981, il intègre la Maison Jean Patou, où il relève, toujours avec Jean-Jacques Picart, le défi de la Haute Couture, que l’on disait moribonde et où ils parviennent à redonner, saison après saison, les couleurs, l’extravagance et la luxuriance qui seront celles des années 80.Ce travail est consacré en 1986 par un premier Dé d’Or, puis par l’Award du créateur étranger le plus influent, décerné par le CFDA à New York en janvier 1987.
En octobre 2002, à l'occasion de la présentation des collections printemps été 2003 et des 15 ans de la maison de Couture, Christian Lacroix reçoit l'insigne de Chevalier de la Légion d'Honneur, remis par Monsieur Bernard Arnault, président de LVMH.
Lacroix est consacré grâce à la subtile conjugaison du futur et du passé sur le mode des étoffes.
DU THEATRE
Fort d’habiller mères et filles au gré des saisons, la scène, côté coulisse, appelle le
talentueux couturier. C’est ainsi qu’il crée les costumes de « C’est la vie », mis en
scène par Alfredo Arias.
Le Métropolitain Opéra de New York se met aussi à l’heure de l’arlésien avec
« La Gaieté Parisienne ». Et bien sûr, nul autre que Lacroix ne peut réaliser les
habits de lumière et autres robes à volant de « Carmen » qui est produit dans les
arènes de Nîmes.
Follement Provence !
LA MAISON Christian Lacroix
1987 : Christian Lacroix rencontre Bernard Arnault qui fonde la Maison de Couture qui portera son nom dans l’hôtel particulier du 73 rue du Faubourg Saint Honoré. La première collection, en juillet 1987, oppose un retour excentrique au minimalisme alors en vigueur. La seconde collection, en janvier 1988, obtiendra un Dé d’Or.
1988 : voit naître la première collection de Prêt-à-Porter, qui ne cesse de puiser son inspiration dans le métissage des cultures .
1989 ; marque l’arrivée des accessoires (bijoux, sacs, chaussures, lunettes, foulards et cravates) et l’ouverture de boutiques à Paris, Arles, Aix-en-Provence, Toulouse, Londres, Genève et au Japon.
1994 : Christian Lacroix crée la ligne “ Bazar ”, complémentaire du Prêt-à-Porter et de la Haute Couture, une collection qui joue plus que jamais avec les folklores et les époques.
1995 : lancement des draps et éponges, gardant ce même état d’esprit, puisque mode et mode de vie ne font qu’un.
1996 : création de la ligne “ Jeans ” : une collection qui mêle passé, présent et futur, inspirée des arts et traditions populaires des ethnies du monde entier.
1997 : les Arts de la Table voient le jour en collaboration avec la maison Christofle.
La même année, un accord de licence est signé avec Pronuptia pour la fabrication et la distribution de la ligne “ Christian Lacroix Mariée ”.
1999 : lancement du Parfum "Christian Lacroix", un ambré-fleuri.
2000 : une ligne de bijoux argent et pierres fines complète les accessoires fantaisie.
2001 : lancement d'une ligne "Christian Lacroix enfant".
2002 : lancement du parfum "Bazar" pour femme et pour homme.
2002 : nomination de Christian Lacroix comme Directeur Artistique de la maison florentine Emilio Pucci (premier défilé à Milan en octobre 2002).
La Maison Christian Lacroix compte aujourd'hui environ 35 points de vente en nom propre ou en corners, et vend ses produits mode dans plus de 1 000 points de vente à travers le monde pour toutes ses griffes.
Aujourd’hui, Lacroix joue les grands orgues dans la cathédrale de la mode : ses
collections ont des airs d’opéra et ses défilés chantent la Provence, le meilleur de la Provence !
L’enseigne de ses boutiques jalonnent les villes de France et de Navarre.
Mais Lacroix, international, demeure arlésien !
Comment en douter ?
« Arles c’était une autre histoire, l’autre côté de la vie, le jeudi, le dimanche,
l’autre famille, un autre siècle, la Provence ».
Retour
 Comte de MIRABEAU 1749 - 1791 Comte de MIRABEAU 1749 - 1791
Gabriel-Honoré Riquetti, comte
de Mirabeau était le fils
aîné du marquis Victor Riquetti de Mirabeau,
économiste issu d'une famille florentine (les Riquet
ou Riquetti) établie en Provence dès le
XVIè s. Né au Bignon, dans le Loiret, et mort
à Paris, il fut le plus grand orateur de
l'Assemblée constituante. Il naquit avec un pied
tordu, deux grandes dents, et surtout une tête
énorme, ce qui a fait dire qu'il était
hydrocéphale.
A l'âge de trois ans, il fut défiguré
par une petite vérole mal soignée. Enfant
espiègle et curieux, il fut très
précoce. "On parle de son savoir dans tout Paris",
écrit son père en 1754, alors qu'il
appréciait très peu son fils et que Gabriel
avait cinq ans. La précocité de Mirabeau
semble s'être accompagnée d'une prise de
conscience de sa laideur, voire de sa différence.
Destiné d'abord à la carrière des
armes, il eut une jeunesse agitée ; son père
le fit enfermer à l'île de Ré, puis
l'envoya guerroyer en Corse. De retour sur le continent, il
épousa Emilie, fille du marquis de Marignane (la
famille de Marignane était l'une des plus puissantes
de Provence). Un fils, mort en bas âge le 8 oct. 1778,
naquit de cette union.
Le jeune ménage étant très
dépensier, Mirabeau père dut bientôt
faire enfermer son fils par lettres de cachet pour le
soustraire à ses créanciers. Gabriel fut donc
emprisonné au château d'If le 20 sept. 1774.
Peu après sa libération, il enleva la
marquise
de Monnier à Pontarlier et
fut condamné à avoir la tête
tranchée. Il s'enfuit alors avec son amante aux
Pays-Bas, où il vécut de sa plume. De nouveau
arrêté, il fut enfermé au donjon de
Vincennes de 1777 au 13 déc. 1780. C'est là
qu'il écrivit à son amie les Lettres de
Sophie. Il y conçut aussi plusieurs autres
ouvrages, parmi lesquels les Lettres de cachet. Il se
sépara d'Emilie à la suite d'un procès
retentissant qui eut lieu à Aix en présence de
toute la noblesse du 7 mai au 5 juillet 1782. Quelque temps
après sa deuxième sortie de prison, il
séduisit la femme du sculpteur Lucas de Montigny, et
en eut un fils qui le suivra dans ses voyages à
travers toute l'Europe, notamment en Allemagne et en
Angleterre. Il obtint de Calonne
une mission secrète en Prusse. Rentré de
Berlin en 1787, il publia en 1787 son Histoire
secrète de la cour de Berlin qui fit scandale.
Calonne refusant de l'employer de nouveau, il s'attaqua
à lui dans sa Dénonciation de l'agiotage
(1787). Il conseilla au Parlement de demanda la
convocation des Etats Généraux, et chercha
à s'y faire envoyer d'abord par l'Alsace, puis par la
Provence. Repoussé par l'assemblée de la
noblesse, malgré ses origines, il fut élu
député par le Tiers-Etat le 6 avril 1789,
à la fois à Aix et à Marseille. Tribun
éloquent et passionné, il joua l'un des
premiers rôles à l'Assemblée
Constituante.
Doué d'une immense culture, Mirabeau connaissait
mieux que presque tous ses collègues les questions
qui pouvaient se poser aux représentants des trois
Etats, notamment en politique étrangère. Ses
vues politiques s'ordonnaient en un système
cohérent : foncièrement royaliste, il voulait
que les provinces mal unies se fondissent sous
l'autorité royale ; mais cette autorité ne
devait pas être absolue, le principe résidant
dans le peuple. Il voulait la suppression des
privilèges et l'égalité religieuse.
Au marquis Henri-Evrard de Dreux-Brézé,
qui ordonnait à l'Assemblée de se dissoudre
(23 juin 1789), Mirabeau fit répondre par cette
phrase célèbre : "Allez dire à votre
maître que nous sommes ici par la volonté du
peuple et que nous n'en sortirons que par la force des
baïonnettes". Certains de ses discours furent
retentissants, comme ceux contre la banqueroute, pour le
maintien du veto absolu, sur le droit de paix et de guerre,
etc. Mais la plupart des députés de
l'Assemblée, notamment Necker,
se méfiaient de lui : c'est pour se soustraire
à son ascendant que l'institution interdit à
ses membres d'être ministres. Mirabeau se mit alors
à intriguer, se heurtant à la jalousie de La
Fayette. Agent double en quelque sorte, il maintint sa
popularité par quelques manifestations d'ardeur
révolutionnaires, tout en servant à Louis XVI
de conseiller et de défenseur rétribué,
et ce grâce au comte de La
Marck qui jouait le rôle
d'intermédiaire entre la Cour et lui.
Malgré ce double jeu et quelques animosités parmi les députés, Mirabeau est élu président de l’Assemblée nationale le 30 janvier 1791.
Il ne profite pas longtemps de cette présidence, il meurt le 2 avril 1791. Son décès est ressenti comme un deuil national.
Inhumé au Panthéon, on l'en retira en
août 1792, quand, après l'ouverture de
l'armoire de fer, on eut la certitude de son double jeu.
L'actuel château du village de Mirabeau, dans le
Vaucluse, a été construit sur les ruines de
celui de la famille du révolutionnaire.
D'ap. Chaussinand-Nogaret,
Guy, Mirabeau,
Paris, Seuil, 1982, 336 p.
Retour
 DARIUS MILHAUD 1892 - 1974 DARIUS MILHAUD 1892 - 1974
Un musicien inspiré des poètes, de sa terre natale, de ses nombreuses terres de passages, de ses convictions religieuses.
« Français né à Aix et de
confession israélite » comme il se
présentait lui-même, il montre des dons
précoces et apprend le violon. Il entre en 1909 au
Conservatoire de Paris, où il suit les classes de
Gédalge et Widor, et complète sa formation
avec Charles Koechlin.
Engagé comme secrétaire
par Paul Claudel, nommé ministre
plénipotentiaire à Rio, il l'accompagne au
Brésil et y découvre le folklore
sud-américain et les rythmes exotiques. Revenu
à Paris, il est associé (par le critique Henri
Collet) au Groupe des Six (avec George Auric, Louis Durey,
Arthur Honegger, Francis Poulenc, Germaine Tailleferre)
rassemblé autour de Cocteau. C'est l'époque du
Boeuf sur le toit, mais aussi des
Choéphores et des Euménides. En
1923, au cours d'un séjour aux Etats-Unis, il
découvre le jazz. Voyageant énormément,
il partage son temps entre la composition et l'enseignement.
En 1940, fuyant les nazis, il repart pour les Etats-Unis,
où il enseigne au Mills College d'Oakland (poste
qu'il conservera jusqu'en 1971). L'arthrite qui le paralyse
peu à peu ralentit à peine son activité
incessante couronnée en 1971 par l'élection
à l'Académie des Beaux-Arts.
Cas rare en ce siècle, Milhaud laisse une oeuvre
proprement gigantesque : plus de 450 opus dans tous les
genres, illustrant toutes les formes et jouant de toutes les
combinaisons instrumentales (« opéra-minute
», « symphonie miniature »). Contrapuntiste
exceptionnel, il a écrit deux quatuors à
cordes qui peuvent être joués ensemble sous
forme d'octuor. Outre la fécondité
jaillissante et l'invention mélodique, les
caractéristiques de son oeuvre sont l'utilisation de
la polytonalité, celle des rythmes exotiques ou du
jazz (La Création du monde, 1923) et le
lyrisme. Au-delà de l'éclectisme des formes et
de la complexité d'écriture, son oeuvre
témoigne d'un style très personnel,
aisément identifiable, une sorte de modernisme
épuré mis au service d'une expression
généreuse.
Darius Milhaud dans ces musiques affirme ses qualités de compositeur et d'homme, étroitement imbriquées, s'alimentant mutuellement. Il s'y affirme Méditerranéen passionné et lyrique, rejetant le pathos et la fausse émotion. OEUVRES MAJEURES :

- L'Homme et son désir,
- Le Boeuf sur le toit,
- La Création du monde,
- Saudades do Brasil, suite de danses ;
- Suite provençale
|
Retour
 OLIVIER MESSIAEN 1908 - 1992 OLIVIER MESSIAEN 1908 - 1992
Avignon, 10 décembre 1908 / Paris, 27 avril 1992.
Né à Avignon dans un milieu intellectuel
particulièrement favorable (son père,
professeur de lettres, traduit Shakespeare, sa mère,
Cécile Sauvage, est une poétesse
renommée), il fait preuve de dons extrêmement
précoces : pour ses dix ans, il reçoit en
cadeau, à sa demande, la partition de
Pelléas, de Debussy, qui est pour lui une
véritable révélation. Très
jeune, il n'a encore que onze ans, il entre au Conservatoire
de Paris, où il sera, entres autres,
l'élève de Paul Dukas (composition) et de
Marcel Dupré (orgue) ; il y obtient rapidement cinq
premiers prix. Faisant preuve d'une curiosité
exceptionnelle, il étudie, parallèlement, le
plain-chant grégorien, la rythmique hindoue, les
chants d'oiseaux, la musique grecque, l'Ecriture sainte ou
la poésie surréaliste, autant de sources
d'inspiration pour son oeuvre à venir.
Son premier opus publié, Le Banquet
céleste (1928), une pièce d'orgue encore
dans la tradition franckiste, attire sur lui l'attention, et
on se presse à l'Eglise de la Trinité,
où il est organiste, pour entendre ses
improvisations. Le succès vient assez vite avec
Les Offrandes oubliées (1931), où il
met déjà en oeuvre une partie de ses
recherches, créant assez rapidement les bases d'un
langage nouveau, très personnel, que l'on retrouve
dans les quatre méditations sur L'Ascension
(1932), puis dans le cycle d'orgue, très novateur, de
La Nativité du Seigneur (1935).
En 1936, découvrant l'originalité de la
musique de Jolivet, il fonde avec celui-ci et deux autres
jeunes musiciens d'avant-garde, Baudrier et Daniel-Lesur, le
groupe « Jeune France », dans le but de promouvoir
la musique nouvelle. Prisonnier de guerre à
Görlitz (1940-42), il y compose un de ses
chefs-d'oeuvre, le Quatuor pour la fin du temps, qui
sera donné en première audition au camp en
1941. Après sa libération, il fait sa
rentrée musicale avec les Visions de l'Amen,
pour deux pianos (1943), qu'il interprète avec la
pianiste Yvonne Loriod (qui sera plus tard son
épouse), mais ses nouvelles oeuvres, notamment les
Trois petites Liturgies de la Présence
Divine (1944), créent le scandale et
déchaînent des critiques d'une rare violence.
Cependant, l'influence de Messiaen sur les jeunes musiciens
- Boulez en tête - devient considérable,
surtout depuis sa nomination au Conservatoire de Paris,
où l'on crée, spécialement pour lui,
une classe d'analyse et d'esthétique musicale (1947),
bientôt fréquentée par toute
l'avant-garde européenne, Boulez, Xenakis, P. Henry,
Stockhausen..., fascinée par la nouveauté de
son langage musical.
Il connaît cependant une période de
désarroi, qu'il surmonte en trouvant une inspiration
nouvelle dans l'étude et la notation approfondie des
chants d'oiseaux, qu'il relève, posté dans la
nature et crayon à la main (Catalogue d'oiseaux,
1956-58).
Reprenant, à partir de 1963, la composition
d'oeuvres d'inspiration religieuse, il écrit coup sur
coup Couleurs de la Cité céleste et
Et exspecto resurrectionem mortuorum (1963), à
la mémoire des victimes de la guerre.
Désormais célèbre, comblé
d'honneurs et de prix (élection à l'Institut
en 1967), il est enfin nommé Professeur de
composition au Conservatoire de Paris. Les commandes
officielles affluent [Transfiguration de Notre
Seigneur (1965-69), Des canyons aux
étoiles (1970-74)], tandis qu'il renoue avec
l'orgue, son instrument de prédilection
[Méditations sur le mystère de la Sainte
Trinité (1969), Le livre du Saint
Sacrement (1984)].
De révolutionnaire iconoclaste et incompris dans
les années 45-50, Messiaen est devenu un musicien
universellement estimé et joué aujourd'hui,
bien que considéré parfois par certains comme
« réactionnaire » dans ses dernières
oeuvres : la polémique qui a suivi la création
de son dernier grand chef-d'oeuvre, l'opéra Saint
François d'Assise (1983), en témoigne.
La nouveauté du langage musical de Messiaen
provient surtout de ses recherches approfondies sur la
durée et sur la couleur, deux notions
qu'il a exploré très loin, comme aucun
compositeur ne l'avait fait avant lui. Quant à son
esthétique, elle pourrait se résumer à
la notion qu'il utilise souvent lui-même de «
valeur ajoutée » : puisant son inspiration
à toutes les sources possibles, il ne les fusionne ni
ne les mélange, comme d'autres, mais les superpose,
les ajoute, créant un style
véritablement décoratif : ondes martenot,
piano brillant, virtuosité instrumentale s'accumulent
dans la richesse d'une harmonie plantureuse, mais tout cela
sans faute de goût, avec la sûreté de
main d'un très grand musicien.
OEUVRES MAJEURES :
 Orgue Orgue
- L'Ascension (1933)
- La Nativité du seigneur (1935)
- Messe de la Pentecôte (1950)
- Livre d'orgue (1951)
- Méditations sur le Mystère de la Sainte Trinité (1969).
|
 Piano Piano
- Vingt regards sur l'enfant Jésus (1944).
- Visions de l'Amen (1943), pour deux pianos.
- Catalogue d'oiseaux (1956-58)
|
Retour
 PABLO PICASSO 1981 - 1973 PABLO PICASSO 1981 - 1973
Pablo Ruiz Blasco y Picasso (Picasso)
Naissance : Málaga, 1881 - Décès : Mougins, 1973
Fils d'un peintre, professeur de dessin et conservateur du musée municipal de Malaga, Pablo Ruiz Blasco y Picasso naîtra dans cette ville le 25 octobre 1881. Il manifestera son goût pour le dessin et la peinture dès l'âge de huit ans, année au cours de laquelle il exécutera "El Picador".
Il s'inscrira à l'École d'Arts de La Corogne à l'âge de onze ans, puis à l'École des Beaux Arts de Barcelone en 1895. Déçu par l'enseignement, Picasso abandonnera ses études trois années plus tard et entreprendra une carrière d'artiste indépendant. Il exposera ses toiles dans un café d'artistes de Barcelone, "Aux quatre chats", et côtoiera les principaux représentants de l'avant-garde espagnole. Le peintre subira les influences de Toulouse-Lautrec ainsi que Vincent Van Gogh et Gauguin au cours de cette période. Picasso exposera "La première Communion" à l'Exposition des Arts Décoratifs de Barcelone à l'âge de quinze ans. Il entreprendra son premier voyage à Paris en 1900, et présentera "Derniers instants" à l'Exposition Universelle. Il abandonnera son nom de Ruiz en 1901, pour adopter celui de sa mère : Picasso.
La période Bleue (1901-1904)
La notion de"période bleue" tire son nom de la couleur qui dominera dans les tableaux de l'artiste au cours de cette période emprunte d'angoisse et de nostalgie. Picasso, très marqué par le suicide de son ami Carlos Casagemas le 17 juin 1901, s'assagira et adoptera des thèmes tournés vers des préoccupations plus sociales et des modèles de conditions modestes. La période bleue culminera avec la composition intitulée "La Vie", en 1903.
La période Rose (1904-1906)
Installé avec de nombreux artistes de sa génération au Bateau-Lavoir en 1904, Picasso épousera Olga, une danseuse des Ballets Russes, en 1918. Il réalisera des décors et des costumes pour la compagnie. Le couple se séparera en 1935. Picasso abordera de nouveaux thèmes tout en mettant l'accent sur l'esthétique de la forme. Le personnage d'Arlequin, ainsi que les saltimbanques, s'imposeront dans l'oeuvre de l'artiste à partir de 1905. La couleur bleue laissera sa place à un gris rosé, doux et triste. Picasso fera la connaissance d'Henri Matisse et André Derain au Salon de l'automne 1905. Les fauves feront alors scandale avec leur première exposition commune. La première approche de l'art moderne découlera d'expériences sur la forme entreprises au cours de l'hiver 1905-1906. Picasso peindra une série de nus d'inspiration classique, aux formes généreuses, détachés de fonds rose vif lors d'un séjour à Gósol, en Catalogne, au cours de l'été 1906. Le "Portrait de Gertrude Stein" ou les "Deux Femmes nues enlacées", peints en 1906, déjà déformées, annonceront les "Demoiselles d'Avignon" de l'année suivante.
Le cubisme (1907-1915)
Ces "Demoiselles d'Avignon" marqueront l'entrée de Picasso dans l'art moderne. Celui-ci rejoindra Braque, son ami qui participera à la naissance du cubisme, au cours de l'été 1911 dans une communauté d'artistes dans le sud de la France. Les deux artistes développeront ensemble le cubisme synthétique à partir de 1912. Il introduiront différents matériaux dans leurs toiles (ficelle, tissu, bois, tôles découpées au chalumeau, papier, carton, morceaux de journaux, cartes à jouer, sables) parfois semées de lettres imprimées au pochoir ou rehaussées de peinture.
Le classicisme (1916-1924)
Pablo Picasso renoncera au cubisme en 1915, alors que les critiques et le public venaient de prendre conscience de l'importance du mouvement. Le peintre, qui s'embourgeoisera socialement, peindra des fresques pour la millionnaire chilienne Eugenia Errazuriz et rencontrera le poète Jean Cocteau avec lequel il travaillera. Le peintre épousera Olga Koklova (1891-1955), une danseuse des Ballets Russes, au cours de l'été 1918. Il la suivra durant ses tournées à Rome, Madrid, Barcelone et Londres, villes dans lesquelles il redécouvrira les maîtres de la tradition européenne qui inspireront son oeuvre.
La fin des années 20 jusqu'à sa mort
Présent à l'exposition surréaliste de 1925, soutenu par André Breton, Picasso ne sera qu'un compagnon de route du mouvement. Il se tournera vers la création plastique de 1925 à 1936. Marie-Thérèse Walter (1909-1977), rencontrée en 1927, deviendra sa compagne et son modèle attitré jusqu'à l'apparition de Dora Maar (1907-1997) dans la vie de l'artiste. Les prises de positions de Picasso hostiles à Franco, en 1937, le condamneront définitivement à l'exil.
Le peintre, qui avait reçu commande d'une peinture pour décorer un pavillon de la République espagnole de l'Exposition internationale de 1937, peindra Guernica en réaction au bombardement meurtrier de la ville le 26 avril 1937. Il s'inscrira au parti communiste en 1944, qu'il quittera neuf années plus tard. Françoise Gilot (1921), devenue sa nouvelle femme, lui inspirera des oeuvres marquées par un retour aux sources méditerranéennes antiques. En 1946, Picasso qui vit depuis quelques mois avec Françoise Gilot, découvre Vallauris et ses poteries. Il s'y installe en 1948 consacrant une grande partie de son activité à la céramique.
Picasso et Françoise emménageront une petite maison de Vallauris en 1948. L'artiste prendra possession des ateliers du Fournas dans la même ville, et travaillera également à la fabrique de poteries Madoura.
Il fréquente la Provence depuis 1912. Amoureux des corridas d'Arles, il s'installe, entre autre, prés d'Aix dans le château de Vauvenargues qu'il achète en 1958, face à la montagne Sainte Victoire, à l'âge de 77 ans.
Il en fit, selon ses voeux, sa demeure éternelle et est enterré dans son jardin. Pablo Picasso décédera d'une embolie pulmonaire à la suite d'une grippe le 8 avril 1973.
La dation
Lorsqu'il meurt en 1973, Picasso laisse un nombre considérable d'œuvres revenant à son épouse et à ses enfants. Une loi - la dation - qui permet aux héritiers de l'artiste de payer leurs droits de succession en cédant des œuvres à l'Etat, permet également d'envisager la création d'un musée exclusivement consacré à Picasso. C'est dans cette perspective que les héritiers de l'artiste acceptent de laisser l'Etat choisir les œuvres qui lui reviendront avant de procéder à leur partage et à l'éparpillement de la collection. Ce sont ainsi 203 peintures, 158 sculptures, 29 tableaux reliefs, 88 céramiques, 1500 dessins, des papiers collés, 1600 gravures, des manuscrits, parmi toutes les œuvres, de caractère souvent intime ou portant la trace de ses recherches, dont Picasso ne s'était jamais séparé, qui sont sélectionnés et constituent le fonds du musée.
La collection personnelle de Picasso, qu'il avait formée au cours de sa vie en rassemblant des œuvres de ses amis (Braque, Matisse, Miro, Derain…), de maîtres qu'il admirait (Cézanne, Le Douanier Rousseau, Degas, Le Nain…), des œuvres primitives, avait été donnée à l'Etat français en 1978 pour être présentée au musée du Louvre. Elle a naturellement rejoint le fonds du musée Picasso.
En 1990, après la mort de Jacqueline, l'épouse de Picasso, le musée a reçu une nouvelle dation. 47 peintures, 2 sculptures, une quarantaine de dessins, des céramiques, des gravures, enrichissent et complètent ainsi la collection initiale. Enfin, en 1992, les archives personnelles de Picasso ont été données à l'Etat. Avec leurs milliers de documents et de photographies, qui couvrent toute la vie de Picasso, elles contribuent à faire du musée Picasso le principal centre d'étude sur la vie et l'œuvre de l'artiste.
La sculpture constitue sans doute une des grandes découvertes du musée Picasso. Nombre des sculptures réalisées par Picasso sont en effet restées dans son atelier et ainsi révélées au grand public après sa mort.
| Peintures |
 |
 |
 |
Centre Pompidou
Artiste

 |
Nature morte "qui"
Peinture
Pablo Ruiz Blasco y Picasso (Picasso)
(1912) |

 |
Arlequin
Peinture
Pablo Ruiz Blasco y Picasso (Picasso)
(1923) |

 |
Le violon
Peinture
Pablo Ruiz Blasco y Picasso (Picasso)
(1914) |

 |
La liseuse
Peinture
Pablo Ruiz Blasco y Picasso (Picasso)
(1920) |

 |
Femmes devant la mer
Peinture
Pablo Ruiz Blasco y Picasso (Picasso)
(1956) |
Exposition Matisse Picasso
Modèle

 |
Autoportrait à la palette
Peinture
Pablo Ruiz Blasco y Picasso (Picasso)
(1906) |
En relation avec

 |
Nature morte à la corbeille d'oranges
Peinture
Henri Matisse
(1912) |
Metropolitan Museum of Art
Modèle

 |
Autoportrait
Peinture
Pablo Ruiz Blasco y Picasso (Picasso)
(1906) |
Musée Picasso
Modèle

 |
Artiste devant sa toile
Peinture
Pablo Ruiz Blasco y Picasso (Picasso)
(1938) |

 |
Autoportrait
Peinture
Pablo Ruiz Blasco y Picasso (Picasso)
(1906) |
| Sculptures |
 |
 |
Centre Pompidou :Uniquement sur le thème: Tête de femme
 |
Tête de femme
Tête
Pablo Ruiz Blasco y Picasso (Picasso)
1957
|
Exposition Matisse Picasso :Dixième salle
 |
Tête de femme
Tête
Pablo Ruiz Blasco y Picasso (Picasso)
1931
|
 |
Tête de femme
Tête
Pablo Ruiz Blasco y Picasso (Picasso)
1931
|
Metropolitan Museum of Art :Art du XXème siècle
 |
Tête de femme
Tête
Pablo Ruiz Blasco y Picasso (Picasso)
1909
|
Musée Picasso :Boisgeloup - L'atelier du sculpteur
 |
Tête de femme
Tête
Pablo Ruiz Blasco y Picasso (Picasso)
Dimensions : 72 cm x 41 cm x 33 cm
1931
|
De Guernica à la guerre
 |
Tête de femme
Portrait
Pablo Ruiz Blasco y Picasso (Picasso)
Dimensions : 65 cm x 54 cm
1939
|
De la période rose aux Demoiselles d'Avignon
 |
Tête
Tête
Pablo Ruiz Blasco y Picasso (Picasso)
Dimensions : 37 cm x 20 cm x 12 cm
1907
|
 |
Tête de femme
Tête
Pablo Ruiz Blasco y Picasso (Picasso)
approx. de 1906 à 1907
|
La collection personnelle de Picasso
 |
Tête (pour la femme au en robe longue)
Tête
Pablo Ruiz Blasco y Picasso (Picasso)
Dimensions : 43 cm x 25 cm x 28 cm
de 1942 à 1952
|
La Crucifixion - La corrida - La Minotauromachie
 |
Tête de femme de profil
Relief
Pablo Ruiz Blasco y Picasso (Picasso)
Dimensions : 19 cm x 16 cm x 5 cm
1933
|
 |
Tête de femme de profil
Relief
Pablo Ruiz Blasco y Picasso (Picasso)
Dimensions : 33 cm x 23 cm x 8 cm
1933
|
 |
Tête de femme de trois quart
Relief
Pablo Ruiz Blasco y Picasso (Picasso)
Dimensions : 15 cm x 21 cm x 7 cm
1933
|
 |
Tête sur fond rouge
Représentation non figurative
Pablo Ruiz Blasco y Picasso (Picasso)
1930
|
Vallauris
 |
Tête de femme
Tête
Pablo Ruiz Blasco y Picasso (Picasso)
Dimensions : 32 cm x 24 cm x 16 cm
1962
|
Quartier latin :
Square Laurent Prache
 |
Monument à Guillaume Apollinaire
Tête
Sculptures dans la ville
Pablo Ruiz Blasco y Picasso (Picasso)
de 1918 à 1959
|
 |
©Succession Picasso 2003-2004
Retour
 MARQUIS DE SADE 1740 - 1814 MARQUIS DE SADE 1740 - 1814
Donatien Alphonse François, marquis de Sade, seigneur de La Coste et de Saumane, coseigneur de Mazan, lieutenant général aux provinces de Bresse, Bugey, Valmorey et Gex, mestre de camp de cavalerie et grand écrivain français, naquit à Paris, en l’hôtel de Condé (où sa mère était dame de compagnie de la princesse), le 2 juin 1740.
Il est le descendant d'une vieille et prestigieuse famille de l'aristocratie de Provence. A 14 ans, il entre dans une école militaire réservée aux fils de la plus ancienne noblesse et, sous-lieutenant un an plus tard, participe à la guerre de Sept ans contre la Prusse. Il y brille par son courage, mais aussi par son goût pour la débauche. Revenu, en 1763, avec le grade de capitaine, il fréquente les actrices de théâtre et les courtisanes. Son père, pour y mettre fin, cherche à le marier au plus vite.
Le 17 mai 1763, il épouse, à regret mais avec l’agrément de la famille royale, Renée-Pélagie Cordier de Launay de Montreuil (issue d'une riche famille parlementaire), dont il aura deux fils et une fille, et qui se signalera par son dévouement conjugal sans réserve. Il ne s'en assagit pas pour autant et fait, dans la même année, son premier séjour en prison pour « débauches outrées ». En 1768, il est à nouveau incarcéré six mois pour avoir enlevé et torturé une passante.
Le 3 avril 1768, il aborde Rose Keller, jeune femme de trente ans, demande l'aumône place des Victoires; elle est à la dernière extrémité de la misère et peut-être tentée par la prostitution, susceptible en tout cas d'accepter en passant une partie de libertinage. Sade l'aborde, s'engage à l'employer dans sa maison en qualité de gouvernante et, sur son acceptation, la conduit à Arcueil, lui fait visiter sa maison, l'entraîne dans une chambre, l'attache sur un lit, la fouette cruellement, enduit ses blessures de pommade, recommence jusqu'à l'orgasme, menace de la tuer si elle ne cesse de crier et se propose, puisqu'on est à Pâques, de la confesser lui-même.
Rose réussit à s'enfuir par la fenêtre, ameute le village; une procédure s'ensuit, à la suite de laquelle Sade est interné pendant sept mois. Punition rigoureuse eu égard à la qualité du condamné et à l'indulgence dont on faisait généralement preuve pour ce genre d'écarts des jeunes gens bien nés à cette époque.
Il donne fêtes et bals dans son domaine provençal de La Coste, voyage en Italie, notamment avec sa belle-sœur, dont il s'est épris. A Marseille, en 1772, il est accusé d'empoisonnement (il avait en fait distribué, lors d'une orgie, des dragées aphrodisiaques à quatre prostituées qui avaient rendu malade l'une d'entre elles) et doit s'enfuir en Savoie. Condamné à mort par contumace, il est arrêté, s'évade, puis cinq ans plus tard (au cours desquels il alterne voyages et scandales), il est arrêté à Paris où il était venu régler ses affaires à la suite du décès de sa mère.
Malgré les interventions de sa femme, il va passer cinq années dans le donjon de Vincennes, écrivant pièces de théâtre et romans pour tromper son ennui, avant d'être transféré à la Bastille où il commence la rédaction des Cent vingt journées de Sodome (1785) puis, deux ans plus tard, Les infortunes de la vertu puis Aline et Valcour. En juillet 1789, dix jours avant la prise de la bastille, il est transféré à Charenton, dans un asile de fous. Il doit abandonner sa bibliothèque de six cents volumes et ses manuscrits.
Il recouvre la liberté, accordée à toutes les victimes de lettres de cachet, en 1790.
Sa femme, lasse de ses violences, obtient la séparation. Ses deux fils émigrent.
Pour survivre dans le Paris révolutionnaire - ses biens, en Provence, ont été pillés et mis sous séquestre - il cherche à faire jouer ses pièces, se lie avec une jeune actrice, Marie Constance Quesnet, qui lui restera fidèle jusqu'au bout. Justine ou les malheurs de la vertu est publié - anonymement - en 1791.
Pour faire oublier ses origines nobles, il milite dans la section révolutionnaire de son quartier. Mais son zèle n'est-il pas assez convaincant ? Fin 1793, il est arrêté et condamné à mort. Oublié dans sa geôle à la suite d'une erreur administrative, il échappe à la guillotine et est libéré en octobre 1794.
Vivant chichement - ses seuls revenus sont ses écrits - il publie en 1795 La philosophie dans le boudoir, Aline et Valcour, La nouvelle Justine et Juliette (Justine et Juliette sont deux sœurs, l'une incarnant la vertu, l'autre le vice, qui subissent des aventures où la luxure le dispute à la cruauté). La presse l'accuse d'être l'auteur de « l'infâme roman » Justine. Il s'en défend maladroitement. En 1801, la police saisit ses ouvrages chez son imprimeur. On ne lui pardonne pas sa violence érotique, son « délire du vice », sa pornographie. Sans jugement, par simple décision administrative, il est enfermé dans l'asile de fous de Charenton. Il va, qualifié de « fou » mais parfaitement lucide, malgré ses suppliques et ses protestations, y mourir le 1er décembre 1814 sans jamais retrouver la liberté. Cet esprit libre, sur ses 74 années de sa vie, en aura passé 30 en prison.
Ses descendants refuseront de porter le titre de marquis, et il faudra attendre le milieu du XXe siècle pour que son œuvre, dans laquelle il a ouvert la voie à la psychologie sexuelle moderne, soit « réhabilitée ».
Cette littérature, longtemps combattue et censurée, a été réhabilitée par Guillaume Apollinaire et les surréalistes et, a sa place de plein droit dans toute bibliothèque. L'édition de référence, la bibliothèque de la Pléiade, consacre d'ailleurs trois volumes à Sade, dont les fameux romans La Nouvelle Justine et Histoire de Juliette.
La Coste, château du Marquis de Sade, se situe à 40 km environ à l'est d'Avignon, blotti au pied du légendaire Mont Ventoux, dans le charmant village de Mazan, au coeur de la Provence. Perché sur une colline dominant les villages alentour, la bâtisse, maintenant en ruine, est caractéristique de l'aristocratie de province. Grand criminel de l'Histoire, le Marquis de Sade ne fait pas partie des héros locaux. La politique régionale de tourisme ne fait d'ailleurs rien pour mettre en valeur le château.
 Citations Citations
"La nature n'a créé les hommes que pour qu'ils s'amusent de tout sur la terre; c'est sa plus chère loi ce sera toujours celle de mon coeur.
Tant pis pour les victimes, il en faut; tout se détruirait dans l'univers, sans les lois profondes de l'équilibre. Ce n'est que par des forfaits que la nature se maintient et reconquiert les droits que lui enlève la vertu.
Nous lui obéissons donc en nous livrant au mal; notre résistance est le seul crime qu'elle ne doive jamais nous pardonner."
Sade
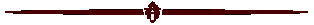
“Le nom seul de cet infâme écrivain exhale une odeur cadavéreuse qui tue la vertu et inspire l’horreur.”
L’ami des Lois du 29 août 1799
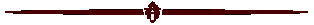
“Les excès de l’imagination à quoi l’entraîne son génie naturel et le disposent ses longues années de captivité, le parti pris follement orgueilleux qui le fait, dans le plaisir comme dans le crime, mettre à l’abri de la satiété ses héros, le souci qu’il montre à varier à l’infini, ne serait-ce qu’en les compliquant toujours d’avantage, les circonstances propices au maintien de leur égarement, ont toute chance de faire surgir de son récit quelque passage d’une outrance manifeste, qui détend le lecteur en lui donnant à penser qu’il n’est pas dupe.”
André Breton, 1940
Retour
 JEAN-HENRI CASIMIR FABRE 1823 - 1915 JEAN-HENRI CASIMIR FABRE 1823 - 1915
C'est à Saint Léons,dans le Lévézou, près de MILLAU (Aveyron) que Jean-Henri Casimir FABRE voit le jour, le 22 décembre 1823. Il passe les premières années de sa jeunesse au Malaval, tout près de son village natal, chez ses grand parents.
Dès son plus jeune âge, il est attiré par la beauté d'un papillon ou d'une sauterelle... Le souvenir de cette enfance restera à jamais gravé dans sa mémoire. A l'âge de 7 ans, il revient à Saint Léons, où il suit sa scolarité.
En 1833, son père emmène toute la famille à Rodez pour y tenir un café. Quatre années plus tard, ils s'installent à Toulouse. Jean-Henri Fabre rentre au séminaire qu'il quitte en 5ème pour gagner sa vie : il se retrouve à vendre des citrons à la foire de Beaucaire.
Il décide alors de se présenter à un concours, afin d'obtenir une bourse pour l'Ecole Normale primaire d'Avignon. Il est reçu, et remporte, au bout de trois ans, son brevet supérieur.
Le jeune Fabre commence sa carrière d'instituteur à Carpentras, il a alors 19 ans. Sa préférence va aux leçons d'histoire naturelle en pleine garrigue.
En 1849, il est nommé professeur de physique à Ajaccio. La nature et les paysages de l'Ile de Beauté le séduisent tellement, qu'il décide d'en étudier la flore et la faune. Le botaniste avignonnais Requien lui transmet aussi son savoir.
Plus tard c'est en compagnie de Moquin-Tendon qu'il herborise. Les grandes compétences de cet enseignant seront déterminantes pour le cheminement de Jean-Henri Fabre, en tant que naturaliste.
De retour sur le continent en 1853, il accepte un poste dans une école d'Avignon, et déménage dans une petite maison, bien modeste, rue des Teinturiers, dans le quartier Saint Dominique. Jean-Henri Fabre se consacre alors à l'étude de la garance ( Rubia tinctoria ) pour en améliorer les rendements en garancine, ou alizarine, colorant naturel. Les draperies d'Elbeuf utilisaient la poudre de garance pour obtenir le rouge des pantalons de l'armée française. Jean-Henri Fabre a déposé trois brevets en 1860.
Le Ministre Victor Duruy lui confie la création de cours du soir pour adultes, mais sa façon très libre d'enseigner déplaît à certains. Il démissionne alors, et s'installe à Orange. Il y séjourne avec toute sa famille, pendant presque une dizaine d'années, et c'est là qu'il écrit la toute première série des « Souvenirs Entomologiques ».
Il adore organiser des excursions botaniques au Mont Ventoux avec ses amis, Théodore Delacour et Bernard Verlot. C'est à cette même période que Jean-Henri Fabre se lie d'amitié avec le philosophe anglais John Stuart-Mill, mais ce dernier décède trop tôt, et leur projet commun, d'établir une « flore du Vaucluse » ne voit jamais le jour. Le destin anéantit alors Jean-Henri Fabre, par la mort de son fils Jules, âgé de 16 ans, le seul de ses six enfants à partager ses passions pour l'observation de la nature. Il lui dédia certaines découvertes d'espèces de plantes qu'il découvrit par la suite.
Les champignons ont toujours intéressé Jean-Henri Fabre. En 1878 il écrit un merveilleux essai sur les « Sphériacées du Vaucluse ». Intarissable au sujet de la truffe, il décrit avec un tel brio son odeur que les gourmets peuvent en retrouver tous les arômes.
A la fin de l'année 1878 paraissent la première série des « Souvenirs Entomologiques ». Cette oeuvre démontre son génie animé par une passion vraie et authentique de la vie, sous toutes ses formes.
Jean-Henri Fabre obtient maints titres scientifiques, malgré cela, il demeure toujours d'une grande simplicité. Il est presque autodidacte. Il maîtrise le dessin , l'aquarelle, et nous lui devons de magnifiques planches sur les champignons, qui rendaient Frédéric Mistral très admiratif.
En 1879, il fait l'acquisition de l'Harmas de Sérignan, où il réside jusqu'à sa mort. Là il peut se livrer à toutes ses expériences et réflexions en toute quiétude. C'était ce dont il avait toujours rêvé. Il y fait aménager sa maison familiale, son bureau, sa bibliothèque.
Ce lieu incomparable est le cadre qui convient enfin à Jean-Henri Fabre, poète et savant. À ce jour, c'est un musée au milieu d'un magnifique jardin botanique qui respire la Provence.
Jean-Henri Fabre fut admiré de Darwin, de Maeterlinck, de Rostand, de Jünger, de Bergson, Roumanille, Mallarmé... On peut le considérer comme un des précurseurs de l'Éthologie, la science du comportement animal et humain. Darwin, à la lecture des « Souvenirs Entomologiques », le qualifia « d'observateur inimitable », en raison de la précision de ses expériences, de ses découvertes sur la vie et les moeurs des insectes. Savants, hommes de lettres..., tous ses contemporains sont subjugués par le personnage, un botaniste certes, mais surtout un être envoûté par la nature. Jean-Henri Fabre a reçu Pasteur chez lui, ainsi que John Stuart Mill, et bien d'autres savants. Cependant, la correspondance de Fabre n'est pas très abondante.
Victor Duruy présente Jean-Henri Fabre à Napoléon III, qui lui décerne la Légion d'honneur.
Raymond Poincaré de passage non loin de Sérignan, fait un détour par l'Harmas, afin de lui rendre hommage.
En 1915, s'éteint celui qui voua toute sa vie à l'étude des insectes, à l'âge de 92 ans. Il est alors enfin reconnu, un peu tardivement, il est vrai, comme il se plaisait à en plaisanter.
Le monde du cinéma a rendu de nombreux hommages à Jean-Henri Fabre. Henri Diamant-Berger a réalisé, en 1951, une biographie du savant « Monsieur Fabre » incarné par Pierre Fresnay ; Patrick Maurin (Patrick Dewaere), y interprétait le rôle d'un enfant du savant. Luis Buñuel se voulait disciple de Fabre, en témoignent dans ses films, l'acuité de son regard et la précision de son sens de l'observation. Louis de Funès relisait régulièrement les « Souvenirs Entomologiques » dont il s'inspirait dans la préparation de ses rôles. Louis de Funès a d'ailleurs transmis sa passion à son fils, Patrick.
Outre le « philosophe entomologique », le « psychologue du monde des Insectes », Jean-Henri Fabre est aussi un merveilleux « félibre » : il nous a laissé son recueil de poèmes « Oubreto Provençalo ». Majoral du Félibrige, on le surnomme avec affection « Le Félibre du Tavan », ( « Poète des Hannetons », en Provençal ). Sur son petit harmonium à l'Harmas, il compose quelques chansons...
Aujourd’hui, sa maison, l’Harmas, est devenue un musée :
- Coordonnées :
- Musée national d'histoire naturelle Jean-Henri FABRE
- Village de Sérignan-du-Comtat,
- situé au nord du département de Vaucluse dans le canton Est d'Orange,
- Tél. 04 90 70 00 44
- Ouverture :
- Se renseigner, actuellement en travaux.
- A voir :
- La " cité des insectes",
- Web site : Micropolis
Retour
 JEAN-MOULIN 1899 - 1943 JEAN-MOULIN 1899 - 1943
ENFANT DU LANGUEDOC ET DE PROVENCE
Enfant du Languedoc et de Provence,
Jean Moulin demeure toute sa vie profondément attaché à
son Languedoc natal et à la Provence des Alpilles. Sa culture littéraire
repose sur des auteurs provençaux, Frédéric Mistral et
Alphonse Daudet. Sa culture artistique est influencée par le sculpteur
bitterrois Jean-Antonin Injalbert, prix de Rome.
Jean-Pierre Moulin, quatrième
et dernier enfant de Blanche Pègue et d'Antonin Moulin naît le
20 juin 1899 à Béziers chef lieu du département très
républicain l'Hérault mais le berceau familial est Saint-Andiol
dans les Alpilles (Bouches du Rhône) où la famille passe toutes
les vacances scolaires. C'est un bourg ancien au sud du Comtat près de
la Durance, sur un axe de grand passage entre Avignon, au nord-ouest, et Aix-en-Provence,
au sud-est, avec en ligne d'horizon au sud-ouest la chaîne calcaire des
Alpilles. Napoléon fit traverser la route impériale par Saint-Andiol
qui devint plus tard la nationale 7, reliant Paris à la Côte d'Azur.
Cette région de Provence célébrée par Alphonse Daudet,
est le lieu de détente et de jeux du jeune Moulin et de son frère
Joseph et sa sœur Laure.
Jean suit une scolarité
des plus classiques, plus attiré par le dessin que par les autres matières.
Un de ses professeurs porte l'appréciation suivante : fera un excellent
élève quand il se décidera à travailler, ce
qu'il fait véritablement à partir de la seconde. Jusqu'en 1917,
la vie de famille est partagée entre Béziers et Saint-Andiol où
il passe ses vacances entouré de ses cousins Escoffier et Sabatier. Les
parents leur font découvrir les Alpilles, les lieux familiers d'Alphonse
Daudet. : Jean est fasciné par un château féodal en ruines,
accroché aux Alpilles, Romanin, surplombant la plaine entre St-Rémy
et St-Andiol, pseudonyme qu'il adoptera pour s'adonner à son violon d'Ingres,
la caricature et le dessin. Ses jeunes années sont très heureuses,
riches de culture et entourées de l'affection des siens.
Il a 15 ans lorsque la Grande
Guerre éclate. Ses compositions françaises et ses caricatures
publiées dans La Baïonnette et La Guerre Sociale qui
révèlent un talent certain, reflètent sa peur de la guerre.
Bachelier en 1917, doué pour les arts graphiques, Jean Moulin aurait
voulu faire une carrière artistique, mais raisonnable, il se laisse convaincre
par son père de faire son droit à la faculté de Montpellier.
Témoin du combat politique de Antonin, il estime que son devoir est plutôt
de servir la République en embrassant la carrière préfectorale. Jusqu'à l'âge de 22 ans, les frontières naturelles de Jean Moulin sont le Lubéron et le Mont Ventoux.
Fidèle
à la Provence, il achètera une bastide " La Lèque
" dotée d'un vaste terrain surplombant Eygalières avec
pour horizon, le Mont Ventoux et le Lubéron.. Accrochée aux Alpilles
et isolée, cette bastide dont il veut faire sa campagne, lui sera utile
dans ses années de clandestinité.
Plus tard, à partir de
février 1922 lorsqu'il devient chef de cabinet du préfet de Savoie
et connaît les déplacements de poste en poste propres à
la carrière d'un sous-préfet et d'un préfet, entrecoupée
de périodes plus ou moins longues dans les cabinets ministériels,
Jean Moulin revient toujours pour quelques vacances à Saint-Andiol où
ses parents se sont installés à la retraite de son père.
L'enfant de Provence choisit comme pseudonyme Romanin pour sa première
exposition de dessins et aquarelles à Chambéry en 1922. Deux photos
illustrent bien cet enracinement : la première avec Laure dans les Alpilles,
à l'été 1938, la deuxième avec son traditionnel
chapeau à l'hiver 1939 - 1940 aux Arceaux, non loin du square du Peyrou,
prise par son ami d'enfance Marcel Bernard. Enfin après sa révocation
le 2 novembre 1940 par le gouvernement de Vichy, Jean s'installe comme cultivateur
à Saint-Andiol. Toute sa vie personnelle mais aussi son action portent
la marque du Languedoc et de la Provence.
Repères chronologiques
1899
20 juin, naissance de Jean Moulin à Béziers
1905
Un des premiers dessins de Jean Moulin La promenade des Anglais
1913
Election d'Antoine-Emile Moulin, père de Jean Moulin, au Conseil Général
de l'Hérault pour représenter le canton de Béziers
1917
Baccalauréat. Inscription à la faculté de droit de Montpellier.
Attaché au cabinet du préfet de l'Hérault
1918
17 avril, il est mobilisé au 2ème Génie.
1919
Retour à Montpellier, il reprend ses études de droit et son
poste au cabinet du Préfet.
AU SERVICE DE L'ETAT
1921
Il adhère aux Jeunesse laïques et républicaines.
1922
6 février, chef de cabinet du préfet de Savoie.
1925
20 novembre, sous-préfet d'Albertville (Savoie).
1930
16 janvier, sous-préfet de Châteaulin (Finistère-Sud).
1933
16 juin, sous-préfet de Thonon.
1934
26 février, sous-préfet rattaché sur sa demande à
la Préfecture de la Seine.
1er juillet, secrétaire général de la Somme.
1936- 1937
juillet 1936 - mai 1937, chef de cabinet de Pierre Cot, ministre de l'Air.
15 mai, nommé préfet de l'Aveyron. Il n'y reste qu'un mois.
1938
Fin janvier - mi-avril, chef de cabinet de Pierre Cot au ministère
du Commerce et de l'Industrie
17 avril, morts de son père Antonin Moulin.
1er juin, préfet de l'Aveyron.
1939
21 février, préfet d'Eure-et-Loir.
Septembre-décembre, Jean Moulin veut être mobilisé.
13 décembre, mobilisé à la base de Tours mais il doit
regagner son poste de préfet sur ordre du ministre de l'Intérieur.
1940
14 juin, bombardement de Chartres, début de l'exode des habitants.
17 juin, arrestation de Jean Moulin par les Allemands. Refusant de signer
un " protocole " infâmant pour l'Armée française,
et sérieusement molesté, il tente de se trancher la gorge.
22 juin, Jean Moulin reprend ses fonctions.
2 novembre, révocation de Jean Moulin par le gouvernement de Vichy.
Décembre, installation officielle à Saint-Andiol.
PIONNIER DE LA RESISTANCE
1941
Janvier-mars, premiers contacts avec des résistants de zone sud.
Avril, entrevue avec Frenay, en zone sud.
9 septembre, Jean Moulin quitte Marseille avec en mains ses visas pour l'Espagne
et le Portugal.
12 octobre, il séjourne à Lisbonne et rédige son rapport.
25 octobre, Jean Moulin rencontre de Gaulle pour la première fois.
24 décembre, de Gaulle le nomme délégué du Comité
national Français, pour la zone libre.
HOMME DE LONDRES ET HOMME DE L'OMBRE
1942
2 janvier, parachutage dans le sud de la France (Eygalières).
Mars, 1ère liaison radio avec Londres.
Avril, création du BIP et du CGE.
Août, Daniel Cordier devient le secrétaire général
de Jean Moulin.
Septembre, création du NAP.
2 octobre, création du Comité de coordination des 3 mouvements
de résistance de la zone sud, présidé par Jean Moulin.
16 octobre, demande officielle d'ouverture de la galerie Romanin, au 22 rue
de France à Nice.
Novembre, Delestraint est nommé chef de l'Armée secrète
unifiée (avec l'accord de Moulin).
27 novembre, première réunion du Comité de coordination
présidé par Jean Moulin à Colonges au Mondor.
1943
26 janvier, création des MUR à Miribel (Ain).
9 février, ouverture de la galerie Romanin (pseudonyme de l'artiste
Jean Moulin), à Nice.
15 février, 2ème séjour à Londres de Moulin, fait
Compagnon de la Libération, nommé Délégué
général pour la France et chargé par de Gaulle de créer
le Conseil de la Résistance.
15 mai, Moulin annonce à de Gaulle la création du Conseil de
la Résistance.
27 mai, Jean Moulin préside la séance inaugurale du Conseil
de la Résistance à Paris.
9 juin, arrestation du général Delestraint à Paris.
21 juin, arrestation de Jean Moulin à Caluire, près de Lyon.
Interrogatoire de Moulin par Klaus Barbie, chef de la Gestapo de Lyon.
8 juillet, date probable de la mort de Jean Moulin à Metz lors de son
transfert en Allemagne.
1945
16 janvier, il est réintégré dans le corps préfectoral
comme préfet de 3e classe au 16 novembre 1940, puis élevé
à la 1ère classe au 16 novembre 1943 et placé en position
d'expectative.
1946
26 novembre, homologation à titre posthume de Jean Moulin au grade
de Général de Division.
HEROS DE LA REPUBLIQUE
1964
Le transfert des cendres de Jean
Moulin au Panthéon lors d'une cérémonie émouvante
et grandiose, télévisée, en présence du président
de la République, le général de Gaulle, la famille de Jean
Moulin, le gouvernement, les Compagnons de la Libération, le 19 décembre
1964 est l'acte de baptème du héros. L'oraison funèbre
d' André Malraux, alors ministre de la Culture, Comme Leclerc entra aux
Invalides, entre ici Jean Moulin... a fait véritablement entrer Jean
Moulin dans la mémoire des Français.
Quelques pseudonymes
Jean Moulin : Romanin (nom d'artiste), Joseph Jean Mercier, Rex,
Max M. X, Jacques Martel,
Orientation bibliographique
Levisse-Touzé, Christine, Jean Moulin, 1899 - 1943, catalogue
d'exposition, Paris-Musées, 1999 et sous sa direction et celle de Jules
Maurin, Jean Moulin, enfant du Languedoc et de Provence, hors série
2001, Les Cahiers de Montpellier, 2003.
Retour
 VINCENT SCOTTO 1874 - 1952 VINCENT SCOTTO 1874 - 1952
ENFANT DE MARSEILLE
Né en 1874 à
Marseille, Vincent Scotto aura été le témoin de " La Belle
Epoque ", des " Années Folles " et du
début de la " l’après-guerre ". Compositeur
populaire aux mille succès, il a été souvent brocardé pour sa
méconnaissance de la musique. Ce qui paraît excessif, car, s’il n’a
pas effectué d’études musicales poussées, Scotto a néanmoins
étudié la musique chez les frères Maristes. Cette culture musicale a
été confirmée par Paulette Zévaco qui, de 1927 à la mort du
compositeur, harmonisa ses mélodies.
Adolescent,
Scotto écrit pour les artistes en représentation à Marseille. Remarqué
par Polin, il est mis en relation avec Christiné qui adapte l’une de
ses compositions, " Le Navigatore " sous le titre
" La Petite Tonkinoise ". On connaît la carrière de
ce " tube ". En 1906, le jeune marseillais rejoint la
capitale et, après quelques mois difficiles, obtient la consécration
avec " Ah ! si vous voulez de l’amour ".
L’invention
mélodique de Scotto ne se dément pas au cours des décennies qui
devaient suivre. " Ses musiques sont étonnamment variées
pour un homme qui travaillait presque à la chaîne ",
lit-on (1). On lui attribue 4000 chansons, 60 opérettes et 200 musiques
de films !
Dans
la chanson, on citera quelques titres :" J’ai deux
amours " (pour Joséphine Baker),
" Prosper " (Maurice Chevalier), " Le
Trompette en bois " (Milton), " Marinella "
(Tino Rossi), " Le plus beau tango du monde " (Alibert),
" Sous les ponts de Paris "...
Vincent Scotto a
également été un compositeur d’opérette fécond. On restreint trop
souvent son apport dans ce domaine à deux trilogies : celle des
opérettes marseillaises, Un de la Canebière, Au pays du soleil
et Trois de la Marine et celles des opérettes à grand spectacle, Violettes
Impériales, La danseuse aux étoiles et Les Amants de
Venise (2).
Or il faut savoir que
dès 1912, Vincent Scotto compose, Susie, créée aux Variétés de
Toulouse. On raconte que la guerre aurait empêché l’ouvrage d’être
représenté à la Gaîté-Lyrique. Susie est à la fois une œuvre
influencée par des succès récents comme La Veuve Joyeuse et une
opérette qui annonce les années folles avec son héroïne qui préfigure
l’émancipation de la femme.
C’est ensuite
toute une série d’ouvrages créés soit à Paris, soit en province
voire à Bruxelles tels que La Poupée du Faubourg (1919), Miss
Détective, Pan-Pan, Zo-Zo ou La Poule des Folies
Bergères...
L’opérette
marseillaise, après le triomphe de La Revue Marseillaise (1932),
déferle alors sur la capitale avec Alibert en tête d’affiche et attire
les foules pendant une douzaine d’années.
Elle s’essouffle
après 1945, mais le septuagénaire Scotto ne renonce pas et aborde l’opérette
à grand spectacle. Sa trilogie, entre 1948 et 1967, totalisera plus de
3500 représentations à Mogador (dont près des 3/4 chantées par Marcel
Merkès).
Il ne faut pas
non plus oublier que Vincent Scotto a composé un nombre important de
musiques de films ; celles de ses opérettes marseillaises portées
à l'écran, certes, mais également la plupart des partitions des films
de Pagnol... entre autres.
"Je laisse tout Wagner pour une chanson de Vincent Scotto”.
Georges Brassens
Composition - filmographie
-
On connaît la chanson (1997) (song "J'ai deux amours") (song "Je ne suis pas bien portant")
... autre titre : Same Old Song (1997)
-
Sabrina (1995) (song "L'amour est une étoile" from operette "Trois de la Marine")
... autre titre : Sabrina (1995) (Germany)
-
3 Tenors in Concert 1994, The (1994) (TV) (song "Sous les ponts de Paris")
... autre titre : Tibor Rudas Presents: The Three Tenors in Concert 1994 (1994) (TV) (USA: complete title)
-
Vincent Scotto (1962) (TV)
-
Arènes joyeuses (1958)
-
Trois de la marine (1957) (operette)
-
Trois de la canebière (1956) (operette "Un de la Canebière")
-
Congrès des belles-mères, Le (1954)
-
Trois jours de bringue à Paris (1954)
-
Anatole chéri (1954)
-
Famille Cucuroux, La (1953)
-
Quand te tues-tu? (1953)
-
Curé de Saint-Amour, Le (1952)
-
Buridan, héros de la tour de Nesle (1952)
-
Ce coquin d'Anatole (1952)
-
Au pays du soleil (1952) (songs)
-
Trois vieilles filles en folie (1952)
-
Étrange Madame X, L' (1951)
... autre titre : Strange Madame X, The (1951) (International: English title)
-
Petites Cardinal, Les (1951)
-
Don d'Adèle, Le (1951)
-
Ingénue libertine, L' (1950)
... autre titre : Minne (1951) (USA)
... autre titre : Minne l'ingénue libertine (1950)
-
Échafaud peut attendre, L' (1949)
-
Belle meunière, La (1948)
... autre titre : Pretty Miller Girl, The (1948) (International: English title)
-
Bout de la route, Le (1948)
-
Ma tante d'Honfleur (1948)
-
Si ça peut vous faire plaisir (1948)
-
Femme sans passé (1948)
-
Colomba (1947)
-
Charcutier de Machonville, Le (1947)
-
Affaire du grand hôtel, L' (1946)
-
Au pays des cigales (1946)
-
Faut ce qu'il faut (1946)
... autre titre : Monsieur Bibi (1946) (France)
-
120, rue de la Gare (1946)
-
Sérénade aux nuages (1945)
... autre titre : Song of the Clouds (1945) (International: English title)
-
Naïs (1945)
-
Cadets de l'océan, Les (1945)
-
Fausse alerte (1945) (song)
... autre titre : French Way, The (1952) (USA)
-
Aventure est au coin de la rue (1944)
-
Un chapeau de paille d'Italie (1944)
... autre titre : Italian Straw Hat, The (1944)
-
Mon amour est près de toi (1943)
-
Domino (1943)
-
Mistral, Le (1943)
-
Femme perdue, La (1942)
-
Romance à trois (1942)
-
Loi du printemps, La (1942)
-
Chambre 13 (1942)
-
Briseur de chaînes, Le (1941)
-
Madame Sans-Gêne (1941)
-
Étrange Suzy, L' (1941)
... autre titre : Strange Suzy (1941) (International: English title)
-
Fille du puisatier, La (1940)
... autre titre : Well-Digger's Daughter, The (1946) (USA)
-
Roi des galéjeurs, Le (1940)
-
Bach en correctionnelle (1939)
-
Restez dîner (1939)
... autre titre : Maruche (1939) (France)
-
Saturnin de Marseille (1939)
... autre titre : Saturnin (1939) (France)
-
Vous seule que j'aime (1939)
-
Gangsters du château d'If, Les (1939)
-
Une java (1939)
-
Ça... c'est du sport (1938)
-
Deux de la réserve (1938)
-
Monsieur de 5 heures, Le (1938)
-
Terre de feu (1938)
... autre titre : Terra di fuoco (1938) (Italy)
-
Femme du boulanger, La (1938)
... autre titre : Baker's Wife, The (1940) (USA)
-
Algiers (1938) ... autre titre : Casbah (1938) (France) [fr]
-
Cinderella (1937)
-
Naples au baiser de feu (1937)
... autre titre : Kiss of Fire, The (1940) (USA)
-
Si tu reviens (1937)
-
Un de la canebière (1937) (songs)
-
Fauteuil 47, Le (1937)
-
Pépé le Moko (1937)
-
Au son des guitares (1936)
-
Aventure à Paris (1936)
... autre titre : Adventure in Paris (1936) (International: English title)
-
Bach détective (1936)
-
Blanchette (1936)
-
Homme du jour, L' (1936) (songs)
... autre titre : Man of the Hour, The (1936)
-
Josette (1936)
-
César (1936)
-
Marinella (1936) (songs)
-
Arènes joyeuses (1935) (songs)
-
Cigalon (1935)
-
Gaîtés de la finance, Les (1935)
-
Merlusse (1935)
-
Rosière des halles, La (1935)
-
Un soir de bombe (1935)
-
Justin de Marseille (1935) (songs)
... autre titre : Ma belle Marseille (1935)
-
Bleus de la marine, Les (1934)
-
Train de huit heures quarante-sept, Le (1934)
-
Tren de las 8'47 (1934)
-
Trois de la marine (1934) (songs)
-
Une nuit de folies (1934)
-
Zouzou (1934)
-
Angèle (1934)
... autre titre : Un de Baumugnes (1934) (France)
-
Agonie des aigles, L' (1933)
... autre titre : Death Agony of the Eagles, The (1934) (USA)
-
Au pays du soleil (1933) (song "J'ai rêvé d'une fleur") (song "Miette")
-
Bach millionnaire (1933)
-
Gendre de Monsieur Poirier, Le (1933)
-
Jofroi (1933)
... autre titre : Ways of Love (1950/I) (USA)
-
Embrassez-moi (1932)
... autre titre : Kiss Me (1932) (International: English title)
-
Marie, légende hongroise (1932)
-
Tavaszi zápor (1932)
... autre titre : Marie, a Hungarian Legend (1932) (USA: literal English title)
... autre titre : Spring Shower (1935) (USA)
... autre titre : Une histoire d'amour (1932) (France)
-
Fanny (1932)
-
Prestige (1932) (song "It's Delightful to Be Married") (uncredited)
-
Roman de Renard, Le (1930)
... autre titre : Story of the Fox, The (1930) (USA)
... autre titre : Tale of the Fox, The (1930)
Acteur - Interprète
-
Amore, L' (1948) .... Jofroi ... autre titre : Ways of Love (1950/II) (USA)
... autre titre : Woman (1948/I)
-
Jofroi (1933) .... Jofroi
... autre titre : Ways of Love (1950/I) (USA)
Par lui même - filmographie
-
Vie des artistes, La (1938)
Avec un succès
constant, pendant près d'un demi-siècle, Vincent Scotto aura chanté "Les
joies et les tristesses du cœur, les passions, les tendresses, les voluptés,
les étreintes, les baisers, les rencontres, les séparations
douloureuses, les souvenirs... l'amour un peu fou des jeunes gens, l'amour
désabusé des vieillards, l'amour des animaux, l'amour de la terre, de la
patrie, de sa ville ou de son village, de son clocher, de sa rue et de sa
maison..." (3)
Jean-Claude Fournier
(1) " Cent
ans de chansons françaises " par C. Brunschwig, L-J. Calvet et
JC. Klein (éditions du Seuil, 1981).
(2) La trilogie citée des opérettes marseillaises réunit les trois
titres les plus célèbres. On lui doit 5 ou 6 autres ouvrages de la même
veine. Par contre,
Violettes Impériales, La Danseuse aux Etoiles et Les Amants de
Venise sont les trois seules opérettes à grand spectacle dont il a
signé la partition.
(3) " Cent ans de chansons à
Marseille ". Édité par la revue municipale
"Marseille" pour le Centre de Rencontre et d’Animation par la
Chanson (octobre 1986).
Retour
|