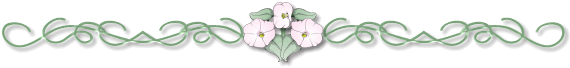| |
|
 AVIGNON AVIGNON

L’historique du nom " Avignon "
A partir de 500 avant JC, la ville s'étend considérablement autour du Rocher. Elle est occupée par le peuple celto-ligure des Cavares. Le nom de la ville date de cette époque. "Aouen(n)ion", un nom d'origine cavare, mais qui a deux interprétations : "ville du vent violent" ou encore "seigneur du fleuve" selon que la traduction est faite à partir du celte ou du ligure. Il semble néanmoins que la seconde interprétation soit plus vraisemblable.
Doit-on dire " en Avignon " ou " à Avignon " ?
La formule " en Avignon ", si elle permet d’éviter un hiatus quelque peu dissonant, est toutefois incorrecte lorsqu’elle s’applique à la ville contenue dans ses limites communales. Son emploi dans ce cas est souvent le fait de l’ignorance ou d’un certain pédantisme basé parfois sur des nostalgies d’Ancien Régime.
Car historiquement, la formule a été employée durant des siècles de manière tout à fait justifiée. En effet la préposition " en " désigne le lieu, " dans ", comme être " en Afrique ". Or, il faut savoir que depuis le XIVe s. le territoire d’Avignon, couvrant plusieurs communes actuelles, constituait un état à part entière appartenant au Saint Siège et gouverné par un vice-légat jusqu’en 1791. On résidait donc " en Avignon ", comme on pouvait résider " en Languedoc " ou " en Provence " etc. Seule autre exception " en Arles ", puisque Arles fut royaume au IXe s. Mais on n’a jamais habité " en Angers " mais " à Angers " et " en Anjou ". L’usage a voulu que l’on tolère de nos jours encore les expressions " en Arles " ou " en Avignon " pour désigner la région autour de la ville, le " pays " formé par les environs, sans limites administratives bien établies.
La formule appropriée est " à Avignon " lorsqu’on parle de la ville stricto sensu comme l’on fait pour " à Aix ", " à Albi " ou " à Amboise ".
A la fois capitale spirituelle, capitale politique, capitale économique et capitale culturelle, Avignon se prévaut d'un patrimoine architectural et artistique exceptionnel qui en fait aujourd'hui encore le plus grand et le plus bel ensemble gothique d'Europe In Altera Romaquot; au XIVe siècle, Avignon a été la capitale du monde chrétien.
Le Palais des Papes du XIVe siècle et le Pont Saint Bénezet du XIIe siècle, sont classés au patrimoine de l'humanité par l'Unesco. Avignon est aujourd'hui un véritable carrefour touristique et culturel. En 2000, elle est désignée ville européenne de la culture. Célèbre aussi grâce au plus grand festival de théâtre vivant du monde, elle accueille plus de 800 spectacles et 570000 spectateurs chaque année.
Les musées et leurs expositions prestigieuses couvrant la période de la préhistoire jusqu'à l'Art contemporain, avec la collection Yvon Lambert répondent à la demande des visiteurs.
Avignon est aussi capitale des Côtes du Rhône et de la gastronomie provençale où les meilleurs chefs vous proposent les spécialités du terroir.
Au carrefour de l'axe fluvial Rhône – Saône, le tourisme fluvial propose de très belles croisières d'agrément dans diverses régions de France et des liaisons fluviales au cœur même de la Provence et de la Camargue. Avignon, porte de la Provence, c'est aussi une croisière de prestige entre les deux capitales de la chrétienté : la croisière des Papes, Avignon-Rome.
Avignon affiche sa culture.
Une capitale culturelle telle qu’Avignon offre forcément une grande diversité d’œuvres et de monuments à ses visiteurs.
Les treize musées que compte la ville vous feront découvrir des sculptures préhistoriques, égyptiennes ou gallo-romaines, un bout d’histoire naturelle, de l’art décoratif, la tradition provençale, de l’art contemporain, l’histoire d’Avignon, le théâtre ou encore des primitifs italiens.
Enfin, le musée Calvet, qui fait partie des trente-deux musées classés en France, vous régalera de ses 28 000 références appartenant à des domaines divers.
Chacun pourra trouver une exposition à son goût parmi les différentes approches de l’art et de la beauté que proposent les musées de la ville.
MUSEE DU PETIT PALAIS
Palais des archevêques,
place du Palais des Papes
Tél. (33) 04 90 86 44 58
Fax. (33) 04 90 82 18 72
- Ouverture :
- du 01/10 au 31/05 de 9h à 13h et de 14h à 17h30
- du 01/06 au 30/09 de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Fermeture :
- Tous les mardi
- Jours fériés : 1/01, 1/05, 14/07, 1/11 et 25/12.
A voir :
 Collection exceptionnelle de peintures italiennes et provençales fin XIIIème - début XVIème siècles ainsi qu'une collection de sculptures Avignonnaises romanes et gothiques.
Collection exceptionnelle de peintures italiennes et provençales fin XIIIème - début XVIème siècles ainsi qu'une collection de sculptures Avignonnaises romanes et gothiques.
Retour
MUSEE CALVET
65, rue Joseph Vernet
Tél. (33) 04 90 86 33 84
Fax. (33) 04 90 14 62 45
- Ouverture :
- Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Fermeture :
- Tous les mardi
- Jours fériés : 1/01, 1/05, 14/07, 1/11 et 25/12.
A voir :
 Dans un magnifique hôtel particulier du XVIIIe siècle. Le musée Calvet est riche d'une collection de Beaux-Arts, peintures et sculptures du XVe au XXe siècle. Donation Marcel Puech : mobilier, faïences, bronzes. Salle d'art moderne Victor Martin : Soutine, Manet, Gleizes…
Dans un magnifique hôtel particulier du XVIIIe siècle. Le musée Calvet est riche d'une collection de Beaux-Arts, peintures et sculptures du XVe au XXe siècle. Donation Marcel Puech : mobilier, faïences, bronzes. Salle d'art moderne Victor Martin : Soutine, Manet, Gleizes…
 Le musée de préhistoire, en cours de réaménagement, il constitue une section du Musée Calvet. Il est consacré aux origines de l’occupation humaine en Vaucluse depuis le paléolithique. Il conserve les principaux éléments de la préhistoire avignonnaise. Plus particulièrement les deux sépultures préhistoriques découvertes en 1965 et 1974, dont les parures et l’utilisation d’ocre rouge permettent de les attribuer au IVème millénaire avant notre ère. Il conserve également un mobilier important, silex et poteries, provenant de l’époque chasséenne (IIIème millénaire avant notre ère) et chalcolithique (2000-1800 av JC), ainsi qu’une précieuse série de stèles anthropomorphes.
Le musée de préhistoire, en cours de réaménagement, il constitue une section du Musée Calvet. Il est consacré aux origines de l’occupation humaine en Vaucluse depuis le paléolithique. Il conserve les principaux éléments de la préhistoire avignonnaise. Plus particulièrement les deux sépultures préhistoriques découvertes en 1965 et 1974, dont les parures et l’utilisation d’ocre rouge permettent de les attribuer au IVème millénaire avant notre ère. Il conserve également un mobilier important, silex et poteries, provenant de l’époque chasséenne (IIIème millénaire avant notre ère) et chalcolithique (2000-1800 av JC), ainsi qu’une précieuse série de stèles anthropomorphes.
Retour
MUSEE LAPIDAIRE
27, rue de la République
Tél. (33) 04 90 86 33 84
Fax. (33) 04 90 14 62 45
- Ouverture :
- Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Fermeture :
- Tous les mardi
- Jours fériés : 1/01, 1/05, et 25/12.
- A voir :
 Il présente la partie sculptée des collections archéologiques du musée Calvet constituée de pièces égyptiennes, grecques, romaines et gallo-romaines, mais aussi de nombreux objets de la vie quotidienne : mobilier funéraire, vases, verreries.
Il présente la partie sculptée des collections archéologiques du musée Calvet constituée de pièces égyptiennes, grecques, romaines et gallo-romaines, mais aussi de nombreux objets de la vie quotidienne : mobilier funéraire, vases, verreries.
Retour
MUSEE ANGLADON
5, rue Laboureur
Tél. (33) 04 90 82 29 03
Fax. (33) 04 90 85 78 07
- Ouverture :
- du mercredi au dimanche de 13h à 18h.
- Jours fériés de 15h à 18h.
Fermeture :
- Tous les lundi et le mardi en basse saison
- A voir :

Ancien hôtel particulier au cœur du vieil Avignon. Au rez-de-chaussée, présentation sobre et moderne des chefs-d'œuvre des XIXe et XXe siècles (Degas, Van Gogh, Cézanne, Picasso, Modigliani…). A l'étage : salons XVIIIème siècle, meubles estampillés, objets d'art, tableaux et dessins (Chardin, Joseph Vernet, H. Robert).
Retour
MUSEE LOUIS VOULAND
17, rue Victor Hugo
Tél. (33) 04 90 86 03 79
Fax. (33) 04 90 85 12 04
- Ouverture :
- du 02/05 au 31/10 de 10h à 12h et de 14h à 18h, le dimanche 14h à 18h
- du 01/11 au 30/04 de 14h à 18h00.
Fermeture :
- Tous les lundi
- Jours fériés : 1/01, 1/05, et 25/12.
Tarifs :
- Gratuit : Entrée libre
- A voir
 Dans un charmant hôtel particulier, une riche collection d'arts décoratifs représentative des 17ème et 18ème siècles : mobilier parisien, faïences du Midi, Moustiers, Marseille, orfèvrerie, tapisseries, peintures et une nouvelle collection d'œuvres de peintres provençaux et avignonnais du 19ème siècle.
Dans un charmant hôtel particulier, une riche collection d'arts décoratifs représentative des 17ème et 18ème siècles : mobilier parisien, faïences du Midi, Moustiers, Marseille, orfèvrerie, tapisseries, peintures et une nouvelle collection d'œuvres de peintres provençaux et avignonnais du 19ème siècle.
Retour
COLLECTION LAMBERT
5, rue violette
Tél. (33) 04 90 16 56 20
Fax. (33) 04 90 16 56 21
- Ouverture :
- du 01 septembre au 30 juinde 11h à 18h
- du 01 juillet au 31 août de 11h à 19h.
- Tous les jours en juillet et août.
Fermeture :
- Tous les lundi
- Périodes de fermeture possible pour montage des expositions.
- A voir :
 Musée d'art contemporain. Elle reflète les grands mouvements de l'art de notre temps : art minimal, art conceptuel, Land art, peinture des années 80, vidéo et photographie pour les années 90. Les plus grands artistes sont représentés : Cy Twombly, Sol LeWitt, Donald Judd, Niele Toroni, Jean-Michel Basquiat, Anselm Kiefer, Christian Boltanski, Nan Goldin, Douglas Gordon et Jenny Halzer.
Deux à trois expositions temporaires à l'année ponctuent la présentation des œuvres du fonds de la Collection Lambert.
Musée d'art contemporain. Elle reflète les grands mouvements de l'art de notre temps : art minimal, art conceptuel, Land art, peinture des années 80, vidéo et photographie pour les années 90. Les plus grands artistes sont représentés : Cy Twombly, Sol LeWitt, Donald Judd, Niele Toroni, Jean-Michel Basquiat, Anselm Kiefer, Christian Boltanski, Nan Goldin, Douglas Gordon et Jenny Halzer.
Deux à trois expositions temporaires à l'année ponctuent la présentation des œuvres du fonds de la Collection Lambert.
Retour
PALAIS DU ROURE
3, rue Collège du Roure
Tél. (33) 04 90 80 80 88
Fax. (33) 04 90 80 84 72
Centre de documentation éthnologique, provençale et archéologique et musée d'arts et traditions populaires.
 Bibliothèque : Bibliothèque :
-
- Ouverture :
- Aux chercheurs du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Fermeture :
- Fermée en août et jours fériés
 Musée : Musée :
-
- Ouverture :
- Visite guidée le mardi à 15h ou sur rendez-vous
Fermeture :
- fermé samedi, dimanche et jours fériés
- A voir :
 Musée : Ancien hôtel de Baroncelli-Javon. Aujourd'hui centre de culture méditerranéenne, plus spécialement consacré à la Provence, son histoire, ses traditions, sa langue et sa littérature.
Musée : Ancien hôtel de Baroncelli-Javon. Aujourd'hui centre de culture méditerranéenne, plus spécialement consacré à la Provence, son histoire, ses traditions, sa langue et sa littérature.
Retour
MAISON JEAN VILAR
8, rue de Mons - montée Paul Puaux
Tél. (33) 04 90 86 59 64
Fax. (33) 04 90 86 00 07
- Ouverture :
- de septembre à juin de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30, le samedi de 10h à 17h
- tous les jours pendant le Festival (juillet) sauf 14 juillet 10h-13h et 14h30-18h30.
- Fermeture :
- dimanche et lundi, jours fériés et mois d'août, fêtes de fin d'année
- A voir :
 Lieu de consultation, d'animation, d'expositions temporaires, de découverte, bibliothèque, vidéothèque, phonothèque, sur le Festival d'Avignon et tous les arts du spectacle. Collections patrimoniales sur Jean Vilar (costumes, maquettes…).
Lieu de consultation, d'animation, d'expositions temporaires, de découverte, bibliothèque, vidéothèque, phonothèque, sur le Festival d'Avignon et tous les arts du spectacle. Collections patrimoniales sur Jean Vilar (costumes, maquettes…).
Retour
LE PALAIS DES PAPES
Clément V, premier pape d’Avignon, croyant que le séjour de la papauté sur les bords du Rhône ne serait que temporaire, établit ses quartiers dans le vaste couvent des Prêcheurs. Il n’en fut pas de même pour ses successeurs immédiats.
Lorsqu’il fut élu en 1316, Jean XXII connaissait déjà fort bien cette ville, dont il avait occupé l’évêché quelques années auparavant. Ce fut donc son ancien palais épiscopal qu’il retint pour résidence. Il s’y installa cependant en pontife, réaménageant les anciens appartements de l’évêque en les agrandissant, et en faisant redécorer le nouvel ensemble.
Jean XXII fit transformer l’ancienne église paroissiale, Saint-Etienne, située sur le flanc sud de la cathédrale Notre-Dame-des-Doms, en chapelle pontificale. Là devaient se dérouler les cérémonies liturgiques majeures de la Curie. Jean XXII fit encore ériger, en 1319, cette fois-ci au sud de son palais, une salle d’audience destinée à abriter les réunions du tribunal de l’audience des causes apostoliques.
 La construction du Palais : 1334-1342 La construction du Palais : 1334-1342
Jean XXII mourut en 1334 et Benoît XII, ancien moine cistercien, lui succéda. Il entreprit dès la première année de son pontificat d’importants travaux dont il confia la réalisation à un maître d’œuvre de ses compatriotes, Pierre Poisson. Ceux-ci débutèrent par l’édification d’une grande tour, puissamment fortifiée et renfermant les biens et personnes les plus précieux de la cour. Cette haute tour fut implantée au sud de l’ancien palais épiscopal, dans lequel Benoît XXII s’était à son tour installé.
Simultanément, Benoît XII fit ériger une nouvelle grande chapelle à deux niveaux superposés. Pierre Poisson poursuivit ensuite, et à un rythme rapide, les travaux en direction du nord (ailes des appartements privés et tour de l’Etude en 1337-1338). Il fit progressivement détruire chacune des ailes de l’ancien palais pour édifier une nouvelle construction, se calquant vraisemblablement sur l’organisation préexistante des espaces. A l’est, les espaces dévolus à la vie officielle (Consistoire et Tinel), à l’ouest les logements des Familiers, au sud, le vaste appartement des hôtes (où séjournèrent rois de France et empereur).
Chacun de ces corps de bâtiments était réparti autour d’une cour. Enfin, un puissant rempart vint renforcer tout le côté méridional et oriental de ce palais, englobant un jardin que Benoît XXII se plut à faire aménager et où il fit probablement installer la ménagerie léguée par son prédécesseur.
 Le Palais de Clément VI à Grégoire XI Le Palais de Clément VI à Grégoire XI
Le schéma de ce premier palais était destiné à perdurer au sein de l’édifice remodelé par Clément VI à compter de 1342, année de son élection. Ce pape tint à doubler la superficie du bâtiment et à renouveler complètement la décoration picturale.
Il commença par développer la superficie de ses appartements privés, par la construction de la tour dite de la Garde-Robe, accolée au mur sud de la tour du Pape. Puis il confia la réalisation du Nouvel Œuvre s’étendant au sud et à l’ouest de cet ensemble à Jean de Louvres, maître d’œuvre originaire de la région parisienne avec qui il entretint d’étroites relations.
L’aile méridionale, composée d’une Grande Audience et d’une Grande Chapelle superposées, fut entreprise dès 1345. Elle marque bien la volonté du pontife de faire réaliser un programme architectural de très grande ampleur, nanti de larges et solennels volumes, parés de multiples sculptures d’inspiration végétale ou animale pour la plupart, tranchant avec les espaces dus à Benoît XII qui en étaient totalement dépourvus. Dans un même élan, fut érigée l’aile occidentale des Grands Dignitaires, destinée au logement et au travail de ces personnes éminentes au sein de la Curie.
Les jardins, où il fit bâtir une superbe fontaine, retinrent eux aussi son attention.
A la mort de Clément VI, en 1352, le palais avait pratiquement déjà la physionomie que nous lui connaissons aujourd’hui. Les pontifes qui lui succédèrent, poursuivirent son embellissement. Innocent VI acheva les travaux entrepris par son prédécesseur, telles les tours Saint-Laurent et de la Gâche (1353-1358), et réalisa un certain nombre d’améliorations portant sur les circulations, comme le pont aujourd’hui détruit et qui portait son nom.
Urbain V, élu en 1362, déjà préoccupé par le projet de retourner en Italie, se contenta de créer la fameuse galerie appelée Roma, dans le jardin supérieur. C’est dans le même esprit que Grégoire XI, élu en 1370, aborda son règne. Il ne fit effectuer dans son palais d’Avignon que de simples travaux d’entretien, plus soucieux de réaliser un projet si souvent caressé : le retour de la papauté à Rome, en 1376.
 Distribution intérieure et décor
Telles furent les grandes étapes de la construction de cet édifice au XIVe s., dont la majeure partie fut dressée en moins de vingt ans à un rythme très rapide, bénéficiant d’un financement exceptionnel qui pesa lourd sur le trésor de l’Eglise. Chacune des dépenses effectuées pour l’achat de matériaux de construction, d’engins, d’échafaudages, pour le paiement des employés (du simple manœuvre payé à la journée aux maîtres d’œuvre et aux peintres appointés) fut enregistrée dans les registres des comptes de la Chambre apostolique, maintenant conservés aux archives secrètes du Vatican à Rome.
C’est cet inestimable trésor qui a permis d’écrire l’histoire de ce palais. Si les murs et une partie de leurs décors demeurent, il est plus difficile de se faire une idée des ornements mobiliers ainsi que de l’activité qui régnait en ce lieu. Impossible, également de dénombrer combien de membres de la Curie travaillaient quotidiennement au palais ou y vivaient.
La seule certitude est que l’activité y était foisonnante : réceptions d’hôtes de marque venus rendre visite au pape à qui l’on remettait les clefs d’un confortable appartement, grandes cérémonies religieuses, travaux administratifs dans les innombrables bureaux où s’affairaient scribes et notaires, écritures comptables et réceptions des collecteurs d’impôts venus des confins de la Chrétienté, etc. Distribution intérieure et décor
Telles furent les grandes étapes de la construction de cet édifice au XIVe s., dont la majeure partie fut dressée en moins de vingt ans à un rythme très rapide, bénéficiant d’un financement exceptionnel qui pesa lourd sur le trésor de l’Eglise. Chacune des dépenses effectuées pour l’achat de matériaux de construction, d’engins, d’échafaudages, pour le paiement des employés (du simple manœuvre payé à la journée aux maîtres d’œuvre et aux peintres appointés) fut enregistrée dans les registres des comptes de la Chambre apostolique, maintenant conservés aux archives secrètes du Vatican à Rome.
C’est cet inestimable trésor qui a permis d’écrire l’histoire de ce palais. Si les murs et une partie de leurs décors demeurent, il est plus difficile de se faire une idée des ornements mobiliers ainsi que de l’activité qui régnait en ce lieu. Impossible, également de dénombrer combien de membres de la Curie travaillaient quotidiennement au palais ou y vivaient.
La seule certitude est que l’activité y était foisonnante : réceptions d’hôtes de marque venus rendre visite au pape à qui l’on remettait les clefs d’un confortable appartement, grandes cérémonies religieuses, travaux administratifs dans les innombrables bureaux où s’affairaient scribes et notaires, écritures comptables et réceptions des collecteurs d’impôts venus des confins de la Chrétienté, etc.
Ce palais, répondant aux multiples besoins de l’un des plus grands princes de son temps, était tout à la fois résidence, lieu de culte, forteresse et " cité administrative " . La valeur démonstrative de ce palais était fondamentale. Un somptueux décor devait rehausser l’éclat et le prestige des actions du pontife en ces murs. Tous étaient revêtus d’enduits colorés, de peintures géométriques, voire de subtils et foisonnants programmes iconographiques.
La majeure partie du décor peint conservé fut commandé par Clément VI. Ce dernier eut à cœur de définir, en étroite relation avec son peintre officiel, Matteo Giovannetti, de grands ensembles témoignant par leurs fastes de la grandeur de l’Eglise, des liens rapprochant Avignon de Rome (chapelle Saint-Martial et chapelle Saint-Jean), soulignant la fonction de telle salle (Consistoire et Grande Audience) ou incitant à une délectation sereine et cultivée de la nature (chambre du Cerf).
Fort de la confiance du pape, maîtrisant parfaitement la technique de la fresque (peinture sur un enduit frais) et libéré par la distance du poids de l’influence de ses maîtres, Giovannetti sut élaborer un langage éblouissant et très personnel, où le sens du portrait (très innovant pour son temps), la virtuosité de ses architectures feintes et le sens de la solennité lui permirent de composer les remarquables ensembles consacrés à Saint-Jean, Saint-Martial et aux prophètes.
Il n’oeuvra pas seul mais entouré d’un atelier, tandis qu’en d’autres lieux des peintres français travaillèrent quelques années plus tôt. Ce fut déjà le cas sous le pontificat de Benoît XII, dans la chambre du Pape, où l’on composa un décor imitant une pergola sur fond de ciel bleu, laissant à des artistes italiens le soin de réaliser les fausses et gracieuses arcatures trilobées des fenêtres, auxquelles pendent d’irréelles cages à oiseaux.
Dans ses nouveaux appartements, Clément VI commanda un décor naturaliste inédit à des peintres demeurés inconnus, qui représentèrent avec beaucoup de réalisme une sombre forêt et les multiples modes de chasser et pêcher, si souvent et minutieusement décrits par les traités de vénerie. Cet important décor peint, malgré les irréparables pertes subies au fil des siècles, constitue un panorama unique en France de la peinture au milieu du XIVe siècle. Ce goût de la couleur se retrouve également dans les carrelages à décor dit " vert et brun ", encore visibles dans le studium (bureau) de Benoît XII et reproduits dans les chambres.
Il était aussi très présent dans les tapisseries vertes ponctuées de roses rouges, dans les tapis assortis, les tentures de soieries de couleur importées d’Italie, ou les draps d’or. Chaque réunion ou cérémonie était précédée du passage du fourrier ornant murs et cathèdres, donnant un cadre coloré à l’emplacement où se tiendrait le pape.
- Le Palais des Papes
- Place du Palais
- Tél. 04 90 27 50 73
- Fax. 04 90 27 50 88
- Ouverture :
- Ouvert tous les jours :
- du 2 novembre au 14 mars de 9h30 à 17h45
- du 15 au 31 mars de 9h30 à 18h30
- du 1er avril au 1er novembre de 9h à 19h.
- De juillet à septembre de 9h à 20h.
- Tarifs :
- Du 15 mars au 1er novembre :
- Tarif plein = 9,50 euros
- Tarif réduit = 7,50 euros
- Du 2 novembre au 14 mars :
- Tarif plein = 7,50 euros
- Tarif réduit = 6 euros
- A noter :
- Fermeture des caisses une heure avant.
Retour
LE PONT SAINT-BENEZET
L’examen des textes, y compris des récits légendaires, et les études archéologiques ont permis de retracer, petit à petit, l’histoire d’un pont fameux depuis ses origines. Les quatre arches et la chapelle que l’on peut voir actuellement sous les vestiges d’un pont qui comportait 22 arches, mesurait plus de 900 mètres, et qui connut bien des vicissitudes.
Il est vraisemblable qu’à l’origine, un pont, dont le souvenir s’est perdu, avait été construit à l’époque romaine. En 1177, la base des piles antiques servait d’assise à de nouvelles piles de pierre surmontées d’un tablier de bois. La construction du nouveau pont fut rapide, puisqu’en janvier 1186 on établissait les droits à percevoir sur les marchandises en le traversant.
Pour une ville en plein essor, l’utilité économique d’un pont - le seul, à cette époque, qui existait sur le Rhône, entre Lyon et la mer - était évidente. C’est cependant une préoccupation pieuse qui anima la confrérie de l’œuvre du Pont et son fondateur Bénezet, pour le lancement de cette entreprise : celle-ci comprenait, outre la construction du pont, l’établissement d’une église avec un cimetière et d’un hospice. C’est le grand mérite de Bénezet d’avoir su, malgré ses origines modestes, susciter des dons abondants et gérer les débuts d’une petite communauté de laïcs charitables qui devait continuer à subsister tant bien que mal après sa mort (1184) et jusqu’à la fin du XIVe siècle.
Cependant, dès la fin du XIIIe siècle, la ville avait pris en charge la gestion de l’édifice, le service religieux fut assuré par l’église Saint-Agricol en 1321, et l’hôpital, dont les bâtiments furent détruits en 1398, avait été remplacé, dès 1370, par un hôpital voisin absorbé par l’œuvre du Pont qui fonctionna jusqu’en 1796. Le pont de Bénezet fut complété par la construction d’une chapelle sur une des piles où Bénezet a été enseveli.
Lors du siège d’Avignon par les troupes du roi Louis VIII, en 1226, le pont fut démoli en des circonstances et dans des proportions que nous ne connaissons pas. Les travaux, vite entrepris, aboutirent à un pont de pierre dont le tablier était nettement plus élevé que celui du précédent. On construisit donc, au-dessus de la chapelle Saint-Bénezet, une chapelle Saint-Nicolas pour la confrérie des Nautoniers. Cette chapelle fut encore agrandie au début du XVIe siècle.
Le pont lui-même, en butte aux crues violentes du Rhône, souffrit constamment de dégâts et fut remanié et réparé à grands frais jusqu’en 1668. Puis on renonça à le réparer ; ses arches disparurent progressivement. En 1674, le corps de Saint-Bénezet fut transféré au couvent des Célestins. Ce qui reste de ses reliques, profanées et dispersées pendant la Révolution, a été transféré dans l’église Saint-Didier en 1854.
Si l’histoire du pont est maintenant à peu près établie, il n’en reste pas moins que la légende de Bénezet ne peut en être dissociée. C’est au milieu du XIIIe siècle que la légende de Bénezet se fixe et se répand grâce aux quêteurs de l’œuvre du Pont qui la lisaient en chaire en vue d’obtenir des fonds. Selon ces récits, Bénezet, jeune berger originaire de l’Ardèche, entendit en 1177 la voix du Christ lui ordonnant d’aller construire un pont sur le Rhône.
Guidé par un ange, il arriva sur la rive droite du Rhône que lui fit traverser un batelier à qui il donna les trois dernières pièces de monnaie qu’il possédait. Bénezet annonça alors sa mission à l’évêque d’Avignon qui le prit pour un simple d’esprit et l’envoya vers le juge. Celui-ci, pour le mettre à l’épreuve, lui désigna une énorme pierre, déclarant que s’il était capable de la porter, il le croyait capable de construire le pont. Bénezet souleva la pierre et la déposa dans le fleuve au départ du futur pont. Aussitôt, les aumônes affluèrent et sa construction fut décidée. Bien qu’il n’y eut jamais officiellement de canonisation, Bénezet fut qualifié de saint dès le début du XIIIe siècle et son culte se répandit, son iconographie le représentant le plus souvent avec la pierre sur l’épaule.
La célèbre chanson Sur le pont d’Avignon… dont on ne connaît pas l’origine, a été popularisée par Adolphe Adam qui en a remis la mélodie à l’honneur dans son opérette Le Sourd ou l’Auberge pleine en 1853.
- Le Pont d'Avignon
- Rue Ferruce
- Tél. 04 90 85 60 16
- Fax. 04 90 86 36 12
- Ouverture :
- Ouvert tous les jours :
- du 1er avril au 1er novembre de 9h à 19h. (21h en juillet - 20h en août et septembre)
- du 2 novembre au 31 mars de 9h30 à 17h45
- Tarifs :
- Tarif plein = 3,50 euros
- Tarif réduit = 3 euros
- A noter :
- Fermeture des caisses une 30 minutes avant.
Retour
LE FESTIVAL
 Vilar, "Régisseur" au Palais des Papes (1947 - 1963) Vilar, "Régisseur" au Palais des Papes (1947 - 1963)
Pendant 17 ans, le Festival reste l'affaire d'un
seul homme, d'une seule équipe, d'un seul lieu, et donc d'une
seule âme. La volonté de Jean Vilar est de toucher
un public jeune, attentif, nouveau, avec un théâtre
différent de celui qui se pratiquait à l'époque
à Paris : "Redonner au théâtre, à l'art
collectif, un lieu autre que le huis clos (…) ; faire respirer
un art qui s'étiole dans des antichambres, dans des caves,
dans des salons ; réconcilier enfin, architecture et
poésie dramatique".
Jean Vilar s'attache une troupe d'acteurs qui viendra
chaque mois de juillet réunir un public de plus en plus nombreux
et de plus en plus fidèle. Ces jeunes talents, ce sont Jean
Negroni, Germaine Montero, Alain Cuny, Michel Bouquet, Jean-Pierre
Jorris, Silvia Montfort, Jeanne Moreau, Daniel Sorano, Maria Casarès.
Gérard Philipe, déjà célèbre
à l'écran, les a rejoints en 1951 ; il en est
resté le symbole, avec ses rôles fameux du Cid (Corneille)
et du Prince de Hombourg (Kleist).
Le Festival devient le fer de lance du renouveau
théâtral français. Il éclaire et conforte
d'autres expériences d'animation théâtrale conduites
alors par les pionniers de "la décentralisation" "(Jean
Dasté à Saint-Étienne, Maurice Sarrazin à
Toulouse, Hubert Gignoux à Rennes, André Clavé
à Colmar). C'est en province que l'art théâtral
se renouvelle par l'action de metteurs en scène, chefs de
troupe, envoyés par l'État en mission dans ce qui
était tenu, à l'époque, pour un désert
culturel. Et Avignon devient autant le rendez-vous de ces pionniers
que l’événement culturel de l’été.
L’expérience d’Avignon doit donc
se pérenniser ; il convient de donner une scène
permanente à Vilar. En 1951, Jeanne Laurent, directrice des
Spectacles au secrétariat d’Etat aux Beaux-Arts, qui
avait encouragé Vilar avant 1947 et soutenu financièrement
la " Semaine d’Art ", sait qu’Avignon
a réussi, que la politique de décentralisation a conquis
un nouveau public. Un comité interministériel voulait
un rapport sur le théâtre national ; elle propose
qu’il soit consacré au théâtre populaire ;
ce qui était possible en province devait l’être
pour Paris et sa banlieue. Le comité, sensible à la
détermination de Jeanne Laurent, lui donne son accord. C’était
le 17 juillet 1951., Elle prend immédiatement le train pour
Avignon et propose l’aventure à Vilar. Il hésite,
consulte la troupe, finit par accepter. La veille de l’enterrement
de Jouvet, il est nommé officiellement directeur du théâtre
national de Chaillot qu’il rebaptise du nom donné par
Gémier : Théâtre national populaire. L’équipe
d’Avignon sera le noyau du TNP.
Jusqu'en 1963, TNP et Festival ont un seul et même
"patron" qui s'appuie sur le travail de militantisme culturel hérité
de l'esprit d'après-guerre pour attirer un public nouveau.
La démarche s’est orientée vers les associations,
les mouvements de la jeunesse, les comités d’entreprises,
beaucoup d’amicales laïques… Des milliers de jeunes
envahissent la ville, dorment dans des campings, chez l’habitant ;
on ouvre des écoles pour les héberger ; dans
le verger Urbain V ; des débats, des dialogues, des
lectures sont organisées ; treize pays participent aux
premières Rencontres internationales de jeunes organisées
par les Centres d’Entraînement aux méthodes d’éducation
active (CEMEA) et le Centre d’échanges artistiques internationaux
(CEAI).
L’administration et la troupe qui s’organisent
à Paris présentent en Avignon des spectacles qui feront
date : Lorenzaccio, Dom Juan, Le Mariage de Figaro,
Meurtre dans la cathédrale, Les Caprices de Marianne, Mère
Courage, La guerre de Troie n’aura pas lieu…
Et chaque été, au palais des Papes,
c'est une liturgie, un rituel, une "communion" qui se déroule.
 L'éclatement du Festival (1964 - 1979) L'éclatement du Festival (1964 - 1979)
Jean Vilar est lui-même le premier conscient
que ce rituel risque aussi de se changer en routine. D'autres personnalités
du théâtre s'affirment également en France.
Enfin, le directeur du TNP est las de cumuler des fonctions écrasantes
; il quitte le palais de Chaillot, en 1963, pour se consacrer au
Festival d'Avignon, qu'il soumet à une interrogation incessante.
Il invite d'autres metteurs en scène : Roger Planchon,
Jorge Lavelli, Antoine Bourseiller. De nouveaux espaces scéniques
sont nés, le cloître des Carmes en 1967, le cloître
des célestins en 1968. Il ouvre le festival à d'autres
disciplines artistiques : la danse dès 1966, avec Maurice
Béjart et Le Ballet du XXe siècle ; le cinéma
en 1967 avec la projection en avant-première de La Chinoise
de Jean-Luc Godard dans la Cour ; le théâtre musical
enfin, avec Orden mise en scène par Jorge Lavelli. Le public
continue de grossir, et la ville est envahie.
Dès lors, le Festival est plus difficile
à maîtriser. De nouvelles générations
en témoignent. Ainsi en 1968, Jean Vilar est-il dans la tourmente.
La vague de la révolte étudiante de mai 1968 atteint
le Festival et conteste son père fondateur. La confusion
des esprits est à son comble et Jean Vilar, pourtant si ouvert
au dialogue avec la jeunesse, en souffrira irrémédiablement.
Il est emporté par une crise cardiaque en 1971.
C’est Paul Puaux, témoin et acteur
de l’aventure, qui poursuit l'entreprise Vilar.
Pendant les années soixante-dix, la cour
d'honneur est confiée aux hérauts de la décentralisation,
les héritiers du TNP vilarien : Georges Wilson, Antoine Bourseiller,
Marcel Maréchal, Gabriel Garran, Guy Rétoré,
Benno Besson, Otomar Krejca. Cloîtres et chapelles sont devenus
d'autres lieux d'aventure ; une autre esthétique s’affirme
avec des partis pris nouveaux comme Einstein on the Beach
de Bob Wilson, Méphisto d’Ariane Mnouchkine,
La Conférence des Oiseaux de Peter Brook ou encore Les
Molière d’Antoine Vitez. ; Lucien Attoun, critique
militant, propose son Théâtre Ouvert où, dès
1971, de jeunes metteurs en scène (Jean-Pierre Vincent, Bruno
Bayen, Jacques Lassalle) mettent en espace, avec peu de moyens,
des textes contemporains (Rezvani, Rufus, Gatti…), avant de
proposer le Gueuloir où les auteurs eux-mêmes sont
invités à présenter leurs textes.
La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon, ancien
monastère du XIVe siècle, situé de l’autre
côté du Rhône, trouve une nouvelle vocation et
devient le Centre international de recherches de création
et d’animation (CIRCA) ; lieu de résidence pour
les artistes (Cunningham en 1976), elle organise aussi des expositions,
des concerts et propose chaque été dans le cadre du
festival, des Rencontres internationales.
Parallèlement au festival, s'est créé
un hors festival : le "off", regroupement épars de compagnies
d’abord locales (Benedetto, Gélas) puis de jeunes équipes
venues des quatre coins de France (Gildas Bourdet, Bernard Sobel…)
désireuses de toucher le public du Festival. Sans pour autant
avoir été sélectionnées et invitées
par la direction du Festival, elles veulent participer à
ce qui devient la grande fête estivale du théâtre,
rendez-vous incontournable des professionnels et du public amateur
de théâtre.
 Avignon, capitale de tous les théâtres (1980 - à nos jours) Avignon, capitale de tous les théâtres (1980 - à nos jours)
En 1980, le Festival est à un nouveau tournant
de son histoire. Géré par une régie municipale,
il n'est pas subventionné par l'État. Il doit être
modernisé et professionnalisé pour faire appel à
la nouvelle génération des créateurs. Paul
Puaux passe la main ; il fait appel à un plus jeune
administrateur : Bernard Faivre d'Arcier, qui pendant cinq ans s'attachera
à ces objectifs.
Désireux de se consacrer à l'histoire de l'aventure
vilarienne, Paul Puaux crée la Maison Jean-Vilar.
Le Festival conquiert son indépendance de
gestion. L'État rentre au sein de son conseil d'administration.
L'équipe d'organisation est développée pour
faire face aux contraintes d'une gestion moderne et à des
exigences techniques de plus en plus sophistiquées. Le dispositif
de la cour d'honneur est transformé, pour accueillir le Théâtre
du Soleil, la troupe d'Ariane Mnouchkine avec ses Shakespeare :
la Nuit des Rois, Richard II.
La nouvelle génération du théâtre
comme de la danse fait une entrée en force : Daniel
Mesguish, (Le Roi Lear), Jean-Pierre Vincent (les Dernières
nouvelles de la peste de Bernard Chartreux), Georges Lavaudant
(les Céphéïdes de Jean-Christophe Bailly),
Jérôme Deschamps (Les Blouses), Manfred Karge
et Matthias Langhoff (La Cerisaie, Le Prince de Hombourg),
Philippe Caubère (La Danse du diable), Pina Bausch
(Kontakthof, Walser, Nelken), Jean-Claude Gallotta (Daphnis
et Chloé, Yves P), Maguy Marin… etc. Le Festival
devient l’une des plus vastes entreprises de spectacles vivants.
Symbole du changement, l’affiche est désormais confiée
chaque année à un plasticien différent.
Vilar avait ouvert le Festival à la danse
au cinéma puis au théâtre musical. Bernard Faivre
d’Arcier , de plain-pied avec son temps, tente l’expérience
de l’audiovisuel, espérant trouver par là un
accroissement d’audience, et susciter l’intérêt
d’un public élargi. L’année suivante il
propose une vaste confrontation du " vivant et de l’artificiel "
à travers une exposition, des rencontres, des débats.
En 1985, Alain Crombecque, ancien directeur artistique
du Festival d'Automne, prend les rênes d'Avignon pour huit
ans. À la confiance accordée à sa génération
théâtrale, il ajoute sa marque personnelle, en insistant
sur les lectures des poètes contemporains (Michel Leiris,
René Char, Louis-René Des Forêts…), sur
la rencontre avec de grands acteurs, (Alain Cuny, Maria Casarès,
Jeanne Moreau), sur la musique contemporaine avec le Centre Acanthes,
les traditions extra-européennnes (musique indienne, africaine,
pakistanaise, iranienne…) ou encore avec la présentation
du Ramayana par différents pays d’Asie du Sud-Est).
Du Mahabharata, présenté par
Peter Brook à la carrière de Boulbon, au programme
théâtral et musical de 1992 consacré à
l'Amérique hispanique, Avignon s'ouvre, en effet, davantage
à l'étranger. Le Festival n'en reste pas moins le
point focal de grandes aventures du théâtre français,
convenant à des spectacles de dimensions hors normes qu'il
serait difficile de présenter ailleurs, comme l'intégrale
du Soulier de satin de Paul Claudel, mis en scène
par Antoine Vitez ou encore la projection dans la Cour d’Honneur
avec orchestre de grands films muets du répertoire cinématographique :
Intolérance de Griffith en 1986, Octobre d’Eisenstein
en 1989.
En 1993 Bernard Faivre d'Arcier revient, à
la demande de la Ville et de l'État, au Festival pour un
nouveau mandat en compagnie de Christiane Bourbonnaud, directrice
administrative de la manifestation, avec, pour nouvelle ambition,
de faire d’Avignon l’un des pôles européens
du théâtre.
L’édifice s’est consolidé
avec un budget renforcé, un public de plus de 120 000 spectateurs,
et la présence de nombreux jeunes acteurs et metteurs en
scène à découvrir ou confirmés, pour
une trentaine de manifestations chaque été qui se
déclinent en plusieurs centaines de représentations,
réparties sur une vingtaine de lieux scéniques, très
différents les uns des autres.
L'histoire du Festival est donc celle d'une grande
continuité : elle a connu quatre directeurs seulement en
cinquante ans, mais aussi une profonde évolution : le Festival
est passé d'un centre unique (une seule troupe, un seul lieu)
à une multitude de propositions artistiques. Face à
cette mutation, la programmation se doit de créer l’événement
qui peut advenir dans la cour d’Honneur (Dom Juan, Médée
par Jacques Lassalle en 1983 et 2000) ou ailleurs (Pièces
de Guerre d’Edward Bond, par Alain Françon en 1994 ;
La Servante d’Olivier Py présentée 24
heures sur 24 au Gymnase Aubanel en 1995…) ou encore avec l’ouverture
aux cultures étrangères, le Japon en 1994, la Russie
en 1997, Taïwan et la Corée en 1998, l’Amérique
latine en 1999, et les théâtres de l’Europe de
l’Est en 2000 et 2001…
Chaque année, c’est donc un abondant
menu qui est proposé …
Le Festival n’est plus la grand-messe d’autrefois,
mais il est toujours le rendez-vous annuel des professionnels et
des amoureux du théâtre, spectateurs néophytes
ou fidèles.
On ne sait décompter exactement le nombre
de spectateurs du Festival ; un habitué va voir plusieurs
spectacles du "in" comme du "off" pendant son séjour. C'est
un public nombreux, passionné et disponible car en vacances.
À en examiner de plus près les comportements, il existe,
en fait, plusieurs publics distincts qui ne vivent pas le festival
au même rythme. Chacun a sa perception de la ville et ses
parcours propres. Il y a les habitués, les fidèles,
voire les "pèlerins" qui organisent leur séjour à
l'avance. Et à l'autre bout de l'échelle des comportements,
les "flâneurs explorateurs" qui se laissent guider par l'instinct
du moment. Certains ne fréquentent que le "in", d'autres
que le "off", mais la plupart se concoctent des mélanges
bien à eux. Le public discute, critique, critique les critiques,
interroge et débat en fin de journée au verger Urbain
V, au pied du palais des Papes, où il aime rencontrer les
artistes présents. C'est un lieu de formation des spectateurs,
apprentissage qui peut se faire aussi au long des séjours
organisés par les CEMEA (l'institution du monde de l'enseignement
qui aménage plusieurs formules d'accueil efficaces et appréciées
pour des jeunes, ou des visiteurs étrangers) ; cette initiation
se fait également à la diable, au hasard des rencontres
du jour et des informations du moment.
Comment organiser son Festival ? Soit en lisant
le programme et en réservant à l'avance des billets
pour le festival lui-même (60 % environ des places sont ainsi
délivrées sur trois à quatre semaines avant
le début du Festival). Soit en partageant le plaisir de la
découverte, entre amis, d'un spectacle déniché
dans un lieu du "off".
Pour les professionnels (français et étrangers),
il existe des lieux de rencontre. D'abord, le quartier général
du Festival lui-même, où se déroulent chaque
matin, les conférences de presse présentant les spectacles.
La Maison du Théâtre à Saint-Louis d'Avignon
ensuite, qui offre, dans la journée, un programme de rencontres,
de colloques, d'étude, où tous les aspects de l'activité
professionnelle du théâtre et de la danse sont évoqués
: économiques, politiques, artistiques, techniques, juridiques,
etc. C'est ainsi (et sous l'impulsion de Jean Vilar lui-même
depuis 1964) qu'Avignon est devenu aussi le rendez-vous des professionnels,
un lieu de réflexion, d’élaboration et de décision
de politique culturelle.
Retour
TOURISME FLUVIAL
Au XIXème siècle, le Rhône était la voie royale pour le transport des hommes et des marchandises. Aujourd’hui encore, Avignon et Lyon constituent l’axe principal des paquebots fluviaux pour l’ensemble du bassin Rhône-Saône-Doubs.
 En 10 ans, le tourisme fluvial a littéralement explosé à Avignon. Alors qu’en 1994, seulement 3 bateaux hôtels naviguaient aux abords de la ville, désormais ce ne sont pas moins de 6 bateaux promenades et 15 bateaux hôtels qui se croisent sur le fleuve.
Ces bateaux offrent toujours une escale d’au moins 24 heures afin de permettre à leurs passagers, une clientèle haut de gamme, principalement nord européenne et nord américaine, de visiter les villes et leurs trésors.
En 10 ans, le tourisme fluvial a littéralement explosé à Avignon. Alors qu’en 1994, seulement 3 bateaux hôtels naviguaient aux abords de la ville, désormais ce ne sont pas moins de 6 bateaux promenades et 15 bateaux hôtels qui se croisent sur le fleuve.
Ces bateaux offrent toujours une escale d’au moins 24 heures afin de permettre à leurs passagers, une clientèle haut de gamme, principalement nord européenne et nord américaine, de visiter les villes et leurs trésors.
Face à l’attrait des touristes pour la voie fluviale, les avignonnais se sont réconciliés avec leur fleuve capricieux. La mairie a mis tous les moyens en œuvre pour valoriser cet élément naturel. La fête du Rhône, au mois de juin donne l’occasion aux avignonnais de mieux connaître le fleuve. Au programme : joutes nautiques et démonstrations de sports nautiques.
De nombreuses promenades ont été aménagées, notamment le chemin de halage qui, longeant les bords de l’île de la Barthelasse, bénéficie d’une vue exceptionnelle sur le Pont Saint-Bénezet et le Palais des Papes, et le chemin piétonnier sous le Pont Saint-Bénezet, qui permet d’assurer la continuité entre le chemin de Halage et le centre-ville via la navette fluviale . Mise en place depuis seulement deux ans, cette navette électrique gratuite relie les deux rives du Rhône, du centre-ville à l’île de la Barthelasse (45 000 passagers en 2002). La ville s’est également dotée d’une capitainerie depuis 1987, qui gère les bateaux amarrés au port ainsi que les bateaux de passage (1 170 bateaux amarrés en 2002).
Avignon n’est plus seulement célèbre pour ses monuments, mais également grâce à son fleuve qui offre un brin de fraîcheur dans le climat estival. Avec plus de 7,6 millions d’euros (50 millions de francs) de retombées économiques, Avignon est propulsée au rang de capitale du tourisme fluvial.
- Informations utiles :
- Office de Tourisme d'Avignon
- 41, cours Jean Jaures
- BP 8
- 84000 Avignon cedex1
- Tél. 04 32 74 32 74
- Fax. 04 90 82 95 03
 Bateaux promenades (6) : Bateaux promenades (6) :
- Bateaux : Mireio / Saône / Delphin / l'Odysée / Le Cygne / Le Calabrun /
- Compagnie : Les Grands Bateaux de Provence
- Tél. 04 90 85 62 25
- Fax. 04 90 85 61 14
 Navette fluviale : Navette fluviale :
- Ouverture :
- Tous les jours
- du 1er avril au 30 juin de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
- du 1er juillet au 30 août de 11h à 21h
- du 1er au 30 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
- d'octobre à décembre le mercredi de 14h-17h30 - le week-end de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.
- Fermeture :
- La navette ne fonctionne pas durant les jours fériés.
- Fermeture de janvier à mars.
- Tarifs :
- La traversée du Rhône entre la halte nautique, au pied du Pont d'Avignon, et le chemin de halage sur l'Ile de la Barthelasse est gratuite.
 Bateaux hôtel (15) : Bateaux hôtel (15) :
- Bateaux : Debussu / Ravel
- Compagnie : Compagnie fluviale de Transport
- Tél. 04 72 76 03 50
- Fax. 04 72 76 03 60
- Bateaux : M.S Camargue / Mistral / M.S Rhône Princess / Van Gogh
- Compagnie : Société Croisi-Europe
- Tél. 03 88 76 44 44
- Fax. 03 88 32 49 96
- Bateaux : M.S Princess de Provence / M.S Cézanne
- Compagnie : Société Peter Deilman
- Tél. 04 78 39 13 06
- Fax. 04 78 29 94 85
- Bateaux : Chardonnay / M.S Provence
- Compagnie : Continentale de Croisières
- Tél. 03 80 53 15 45
- Fax.. 03 80 41 67 73
- Bateaux : M.S Viking Rhône / M.S Viking Burgundy
- Compagnie : Aqua Viva
- Tél. 04 90 86 08 23
- Fax. 04 32 74 16 97
- Bateaux : Le Napoléon / L'Amarylis
- Compagnie : Fluviale Auxerroise SARL
- Tél. 03 80 39 24 09
- Fax. 03 80 77 94 24
- Bateau : Le Phénicien
- Compagnie : Rhône Croisière
- Tél. 04 42 41 19 14
- Fax. 04 42 41 19 15
Retour
|